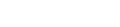UNOG - United Nations Office at Geneva
UNOG - United Nations Office at Geneva
01/21/2026 | News release | Distributed by Public on 01/21/2026 14:35
Aux confins de la guerre : tensions à la frontière centrafricaine avec le Soudan
À l'approche de Birao, le terrain s'aplanit. Les routes se perdent dans la poussière ocre, avalées par la savane. Dans cette ville coupée du monde, à l'extrémité nord de la République centrafricaine, les voitures se font rares, mais les motos sont légion. À moins de deux heures de piste de la frontière soudanaise, Birao marque la lisière d'un pays qui tente de se reconstruire, tout en absorbant les ondes de choc d'une guerre voisine.
Depuis le début du conflit au Soudan, des dizaines de milliers de civils fuyant vers le sud ont trouvé refuge ici. Ils ont emporté avec eux ce qu'ils ont pu sauver de leurs affaires - et le poids de la crise humanitaire la plus étendue au monde.
En cette journée étouffante de novembre, au début de la saison sèche, une femme d'une taille imposante se tient à l'ombre d'un arbre, près d'une tente en plastique. Autour d'elle, les maisons de paille et de tôle de Korsi, un quartier improvisé à la périphérie de Birao pour absorber l'afflux de nouveaux arrivants.
Nous l'appellerons Nafeesa. Elle dit venir d'une ville au sud de Khartoum, à plus de mille kilomètres de là.
Lorsque la guerre éclate dans la capitale soudanaise, en avril 2023, elle fuit avec sa famille en direction de l'Ouest, dans la région du Darfour. Son mari y ouvre une petite boutique sur un marché local. Un jour, des hommes en arme font irruption dans la boutique et le menacent. Il parvient à s'échapper mais est suivi jusque chez lui.
Les nouvelles de l'ONU/Alban Mended de Leon
Nafeesa (au centre, de dos), dont le vrai nom a été changé pour des raisons de sécurité, dit venir d'une ville au sud de Khartoum, à plus de mille kilomètres de là.
Cette nuit-là, les hommes reviennent pour finir ce qu'ils ont commencé.
« Ils sont arrivés à une heure et demie du matin », se souvient Nafeesa, dont le vrai nom a été modifié pour des raisons de sécurité, dans son arabe natal. « Il s'est levé du lit, et ils lui ont tiré dessus à trois reprises ».
Elle et son fils de neuf ans sont ligotés pendant que son mari agonise. « Ils ont pris notre argent, nos affaires, nos vêtements ».
À propos de cet article
Ce reportage a été réalisé avec le soutien de la mission de maintien de la paix des Nations Unies en République centrafricaine (MINUSCA). Il examine la façon dont la guerre civile au Soudan voisin affecte les communautés vivant dans des zones frontalières, où la mission est chargée de les protéger.
La mission en bref
- Déploiement : 2014, à la suite du déclenchement de la guerre civile en République centrafricaine
- Mandat : protection des civils ; appui à la stabilisation, au processus de paix et au rétablissement de l'autorité de l'État
- Effectifs : 18 313 personnels civils et en uniforme, dont 13 307 soldats de la paix
- Nord de la Centrafrique : environ 900 Casques bleus, dont 600 à Birao
Sa voix est douce. Ses mains sont ornées de fins motifs au henné. Mais son visage est marqué par le deuil et l'exil.
Après le meurtre, elle décide de quitter le Soudan avec le reste de sa famille.
La guerre déborde
L'incident qui a brisé la vie de Nafeesa tire son origine dans la rupture des relations entre le chef de l'armée soudanaise, le général Abdel Fattah al-Burhan, et le commandant paramilitaire des Forces de soutien rapide (RSF), Mohamed Hamdan Daglo.
Près de trois ans plus tard, ce qui n'était au départ qu'une lutte de pouvoir à Khartoum s'est mué en une guerre totale. Environ 30 millions de personnes ont été plongées dans la détresse humanitaire. Plus de 10 millions ont fui leur foyer, dont la moitié sont des enfants. Depuis l'été 2024, la famine s'est installée dans plusieurs régions du pays.
À la fin octobre 2025, le conflit franchit un nouveau seuil. Après plus de 500 jours de siège, les RSF s'emparent de la ville d'El Fasher, dernier bastion gouvernemental au Darfour du Nord. Des centaines de milliers de personnes sont déplacées. Des témoignages font état de massacres ciblant des communautés non arabes, de viols de masse, d'exécutions sommaires.
Pour de nombreux habitants du Darfour, la violence a un goût de déjà-vu. Les RSF sont issues des milices janjawids, actives lors de la guerre du Darfour, il y a plus de 20 ans. À l'époque déjà, elles affrontaient les communautés non arabes - Fours, Masalits, Zaghawa - avec l'appui du gouvernement soudanais.
Quelques semaines avant la chute d'El Fasher, début octobre, la Cour pénale internationale condamnait Ali Muhammad Ali Abd-Al Rahman, dit Ali Kushayb, ancien chef janjawid, pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis au Darfour en 2003 et 2004.
Depuis, les procureurs de la cour en charge du dossier n'ont de cesse d'alerter sur le fait que des atrocités similaires sont de nouveau perpétrées aujourd'hui dans la région, le viol servant encore d'arme de guerre.
Une frontière sans barrières
Comme Nafeesa, de nombreux habitants du Darfour passent au sud, en Centrafrique, et arrivent à Am Dafock, une ville-frontière bâtie sur des terres marécageuses, à deux heures de Birao.
Il n'y a ni barrière, ni clôture. Juste un lit de rivière presque asséché, qui recouvre la ligne invisible tracée sur les cartes.
Ils sont venus à une heure et demie du matin... Il s'est levé du lit, et ils lui ont tiré dessus à trois reprises
Les villageois circulent librement d'un côté comme de l'autre - à pied, à dos d'âne, avec du bétail. Les hommes armés aussi.
Pour Ramadan Abdel Kader, le sous-préfet d'Am Dafock, l'histoire récente de la ville est définie par la peur. « La population a été plongée dans une détresse absolue », raconte-t-il. Au cours des derniers mois, des hommes soupçonnés d'appartenir aux RSF traversaient régulièrement la frontière pour piller, tuer et terroriser les résidents.
Au plus fort des violences, jusqu'à 11 500 personnes - une large part de la population - ont fui leurs maisons.
Nombreux d'entre eux se sont réfugiés près de la base locale de la MINUSCA, la mission de maintien de la paix de l'ONU en Centrafrique, qui s'est installée à Am Dafock après le début de la crise soudanaise. « Sans sa présence, cette localité aurait été submergée par des éléments armés venus du Soudan », assure le responsable.
UN News /Alban Mendes de Leon
Dans le nord de la République centrafricaine, où les inondations saisonnières coupent régulièrement la région du reste du pays, les forces de la MINUSCA patrouillent sur de vastes distances, dans des zones dotées d'infrastructures étatiques minimales.
Née d'une autre guerre
La MINUSCA n'est pourtant pas là à cause du Soudan. Son déploiement date de 2014, lorsque la Centrafrique a basculé dans le chaos après la prise de pouvoir par la force de la Séléka, une coalition majoritairement musulmane qui avait renversé le président de l'époque, François Bozizé. S'en est suivi une spirale de violences : exactions, pillages, massacres de civils, violences sexuelles, commis tant par les Séléka que par les anti-Balaka, des milices à majorité chrétienne.
Le pays frôle alors l'effondrement. Des communautés entières sont déplacées. L'autorité de l'État disparaît en dehors de la capitale, Bangui.
Plus de dix ans plus tard, la Séléka a été dissoute, deux élections présidentielles ont eu lieu, et un accord de paix signé en 2019 a intégré 14 groupes armés dans un processus politique. Mais de vastes zones demeurent instables. La mission onusienne maintient plus de 13 000 Casques bleus dans cette nation enclavée d'Afrique centrale.
Nous opérons dans un environnement où l'État est encore en reconstruction
Dans le nord, régulièrement coupé du reste du pays par des inondations saisonnières, les patrouilles s'étendent sur de longues distances, dans des zones dotées d'infrastructures étatiques minimales. « Nous opérons dans un environnement où l'État est encore en reconstruction », explique le major Obed Mumba, à la tête des 200 Casques bleus basés à Am Dafock. « Notre priorité est la protection des civils et la prévention de toute escalade ».
La dimension humaine est centrale. « Nous parlons chaque jour avec la population », explique la major Sifamwelwa Akalaluka, chargée de l'engagement communautaire de la MINUSCA à Birao. « Femmes, jeunes, chefs locaux. Cela nous permet de repérer les tensions avant qu'elles ne dégénèrent ».
Quand la terre devient un enjeu
Car les tensions ne proviennent pas seulement des hommes armés. Elles naissent aussi de la compétition pour la terre et l'eau entre éleveurs soudanais en fuite, avec leurs troupeaux, et agriculteurs centrafricains, dont les champs bordent les routes de transhumance.
Les cultures sont piétinées. Les puits surexploités. Les conflits se multiplient. Avec l'intensification du conflit soudanais au Darfour, courant 2025, ce qui n'était autrefois qu'une source de friction saisonnière tourne à l'affrontement.
En septembre, la situation atteint un point de rupture, mise à profit par les groupes armés. « Nous avons enregistré de nombreux viols », raconte Tamia Célestin, leader communautaire à Am Dafock. « Des jeunes filles de 12 ou 13 ans à peine. Les gens avaient peur d'aller aux champs ». Ce mois-là, six corps sont retrouvés, criblés de balles, et près de 26 cas de violences sexuelles recensés.
ONU Info / Alban Mendes de Leon
Les réfugiés soudanais en République centrafricaine apprennent à travailler la terre pour survivre.
Parler sous les arbres
La MINUSCA promeut alors l'idée d'un dialogue transfrontalier. Du 27 au 30 octobre 2025, chefs religieux, autorités traditionnelles, commerçants, comités de transhumance - et neuf représentantes des femmes - se retrouvent à Am Dafock. En l'absence de salle communale, on s'assoit sur des bancs, sur des nattes, à l'ombre des arbres.
Au total, plus d'une centaine de délégués répondent à l'appel. « Ce n'était pas facile », se souvient Tamia Célestin. « Mais les gens ont parlé ».
Les griefs s'expriment. Les accusations fusent. Les limites sont redéfinies - non sur des cartes, mais par les mots.
Les discussions aboutissent à la signature d'un accord local. Ce dernier interdit le port d'armes, réaffirme les couloirs de transhumance et prévoit de règlement des conflits par des comités locaux. Depuis, selon les habitants, les coups de feu se sont tus pour la plupart. Les champs sont de nouveau cultivés. La frontière reste ouverte - mais plus calme.
À notre arrivée, deux semaines plus tard, l'effervescence gagne les préparatifs des prochaines élections générales en Centrafrique. Les habitants d'Am Dafock s'apprêtent à élire un maire officiel pour la première fois depuis des décennies.
Le 28 décembre, les Centrafricains reconduisent largement le président sortant, Faustin-Archange Touadéra, pour un troisième mandat. Pour beaucoup ici, le résultat incarne l'espoir d'une normalité - ou du moins d'une continuité - dans une région qui a longtemps manqué des deux.
Mais cette promesse demeure fragile.
ONU Info / Alban Mendes de Leon
La major Sifamwelwa Akalaluka, chargée de l'engagement communautaire de la MINUSCA à Birao, s'entretient avec des femmes sur le marché de la ville.
L'attente d'un lieu sûr
En 2023, après son arrivée en Centrafrique, suite au meurtre de son mari, Nafeesa ne s'attarde pas à Am Dafock. L'insécurité la pousse vers Birao, où l'agence de l'ONU pour les réfugiés (HCR) l'enregistre et organise l'aide. « Ils nous ont donné des couvertures, des matelas pour les enfants. Et cette maison », dit-elle.
Aujourd'hui, plus de 27 000 réfugiés soudanais vivent autour de Birao, une ville qui compte à la base moins de 18 000 habitants. « C'est une situation inhabituelle », reconnaît Jofroy Fabrice Sanguebe-Nadji, un responsable du HCR sur le terrain. « L'arrivée d'un nombre aussi important de réfugiés a exercé une pression considérable sur des ressources qui étaient déjà limitées ». L'accès à l'eau et aux services de base est mis à rude épreuve.
L'autre jour, ils ont tué un garçon dans le quartier. Ils sont entrés la nuit. On ne l'a jamais retrouvé
À Korsi, les agences humanitaires ont façonné un équilibre fragile. « Ce n'est pas un camp », insiste-t-il. « Les réfugiés vivent avec la communauté hôte ». Mais leur dépendance à l'aide reste massive, alors même que les financements s'amenuisent. « La difficulté majeure aujourd'hui, c'est le manque criant de fonds », explique le responsable.
Nafeesa survit en vendant ce qu'elle peut. « On m'a donné un étalage pour le marché. Dieu merci, ça va ».
La situation sécuritaire, elle, reste incertaine. « L'autre jour, ils ont tué un garçon dans le quartier », confie-t-elle. « Ils sont entrés la nuit. On ne l'a jamais retrouvé ».
Retourner au Soudan est impensable. Mais demeurer à Birao n'est pas garanti. Sans protection durable, sans travail stable, l'exil n'est qu'un répit.
Alors Nafeesa attend. Comme le calme le long de la frontière soudanaise, son refuge tient - pour l'instant.
Urgence humanitaire
- Après bientôt trois ans de guerre, les financements humanitaires destinés au Soudan ont fortement chuté. Le Programme alimentaire mondial (PAM) a averti que l'aide alimentaire pourrait être interrompue dès le mois de mars.
- Pour 2026, l'ONU sollicite 2,9 milliards de dollars afin de fournir une aide vitale à 20 millions de personnes au Soudan, ainsi que 500 millions de dollars supplémentaires pour venir en aide à 2,6 millions de réfugiés soudanais ayant fui le pays.
- L'ONU demande également 264 millions de dollars pour soutenir 1,3 million de personnes en République centrafricaine.
Faire un don
Les contributions à ces agences permettent de maintenir les distributions alimentaires, l'accès à un abri, aux soins de santé et aux mécanismes de protection pour les civils touchés par le conflit :
- Programme alimentaire mondial (PAM) - Aide alimentaire d'urgence au Soudan et en République centrafricaine
- Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) - Protection et assistance aux réfugiés et aux personnes déplacées originaires du Soudan
Pour aller plus loin
Pour approfondir, consultez notre couverture consacrée à la guerre civile au Soudan, à la République centrafricaine et aux opérations de maintien de la paix, ainsi que les sites officiels de la MINUSCA et du maintien de la paix des Nations Unies.
UNOG - United Nations Office at Geneva published this content on January 21, 2026, and is solely responsible for the information contained herein. Distributed via Public Technologies (PUBT), unedited and unaltered, on January 21, 2026 at 20:35 UTC. If you believe the information included in the content is inaccurate or outdated and requires editing or removal, please contact us at [email protected]