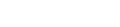Prime Minister of Hungary
Prime Minister of Hungary
12/17/2025 | Press release | Distributed by Public on 12/17/2025 03:20
Interview vidéo de Viktor Orbán dans l’émission d’ATV « Bilan – avec Egon Rónai »
Egon Rónai : Bonsoir à toutes et à tous. Vous regardez une nouvelle édition de « Bilan - avec Egon Rónai ». Notre invité aujourd'hui est Viktor Orbán, Premier ministre. Soyez le bienvenu.
Bonsoir !
Cela fait quinze ans que vous n'êtes pas venu chez ATV. C'est tellement long… et il y a tant de questions restées en suspens que je ne vais même pas essayer de tout reprendre…
Mais je suis passé ailleurs, tout de même.
Ce cadre-ci ne suffirait pas pour tout aborder. Mais nous aussi, nous vous attendions, et maintenant que vous êtes là…
Je vous remercie de m'avoir invité.
…je vais évidemment essayer de me concentrer avant tout sur la situation actuelle, et je vous poserai des questions en lien avec celle-ci. Je pense que c'est mieux ainsi.
Et moi, je vais essayer de courir mes propres tours de piste.
Commençons par votre voyage aux États-Unis.
Allons-y.
Vous vous êtes rendu là-bas avec une délégation inhabituellement nombreuse. D'une ampleur comparable à celle des délégations que Donald Trump a l'habitude de mener, et c'était lui votre hôte. Lui, il se déplace souvent avec une centaine de personnes…
Même plus.
…des journalistes, des membres de son équipe. Mais vous, vous avez pris un vol Wizz Air. C'était pour donner l'exemple, pour montrer qu'on ne fait pas dans le luxe ?
Non. Il n'y avait simplement aucun avion d'État disponible pour ce déplacement. C'était une situation contrainte. Il y a des règles : si un avion de l'armée est en bon état et accessible, il faut l'utiliser. Si ce n'est pas possible, on le remplace : c'est ce que je fais aussi. Et si, au final, vous ne pouvez même pas louer un appareil, alors vous prenez un billet sur un vol commercial.
À quel point cet avion de Wizz Air était-il inconfortable ? Je ne demande pas cela à cause de Wizz Air, mais c'est un vol low-cost, et vous n'avez pas vraiment l'habitude de ce genre de conditions.
D'accord. Wizz Air est une entreprise sérieuse. À l'aller, j'ai volé avec Wizz Air, puis au retour, de Reykjavik à Manchester, j'ai pris un easyJet, et de là un Ryanair jusqu'à Budapest. Donc j'ai fait le tour des trois compagnies low-cost…
Vous avez fait le grand chelem du low-cost.
Exactement. Je connais tout, maintenant. Mais disons que l'avion Wizz Air était bon, et neuf. Wizz Air est une solide entreprise hongroise, ils ont été corrects avec nous. Mais la question n'est pas de savoir si c'est confortable ou non : quand vous avez autant de monde dans l'avion, vous passez votre temps à discuter et à travailler. J'ai réglé plusieurs dossiers avec les ministres pendant le vol. Donc vous n'avez pas le temps de vous ennuyer, l'avion importe peu : s'il ne pleut pas dedans, si on vous donne à manger, et que vous arrivez à destination, c'est largement suffisant.
Il y a eu une réunion de gouvernement et une conférence de presse en même temps, et j'imagine qu'il y a aussi eu un peu de repos pendant le trajet. Cela ne vous a pas paru étrange qu'à l'aéroport on ne vous accueille pas avec le protocole d'État habituel ?
L'État américain est paralysé. En ce moment, il est… à l'arrêt. C'est ce qu'ils appellent le shutdown.
Oui.
Il n'y a pas de budget, et l'État est, pour ainsi dire, immobilisé. Ils ont bien d'autres soucis, les pauvres, que de savoir qui arrive où, puisque la police, l'armée et un certain nombre d'unités mobilisables en cas de catastrophe doivent fonctionner même en l'absence de budget. Donc la situation budgétaire là-bas est chaotique.
Donc vous saviez à l'avance…
Bien sûr.
…qu'il n'y aurait ni tapis rouge, ni orchestre, ni parade militaire ?
Je m'attendais plutôt à ce qu'on me demande comment gérer une situation sans budget, puisque moi, cette année, j'en suis à mon 35ᵉ budget. Au 36ᵉ !
Et en plus toujours préparé longtemps à l'avance, mais nous aurons peut-être l'occasion d'en parler. Les sanctions mises en place par le président Trump ont sérieusement bouleversé l'agenda de la politique mondiale. Ces derniers temps, de très nombreuses négociations ont eu lieu, souvent de manière soudaine. Vous saviez où vous mettiez les pieds ? C'est-à-dire : lorsque vous avez convenu avec le président Trump, votre équipe ou vous-même, que vous alliez venir, saviez-vous par exemple que vous obtiendriez une exemption de sanctions ? Ou avez-vous dû négocier cela sur place ?
Je ne savais rien du tout. C'est un homme d'affaires, le président des États-Unis est un homme d'affaires, et pas n'importe lequel. Avec lui, il n'y a pas de « bon, on s'accorde à l'avance et on fait semblant ensuite ». Il laisse tout ouvert jusqu'à la dernière minute, et il ne conclut que lorsqu'il estime que le moment est venu pour lui. Moi, j'y suis allé pour qu'il conclue au moment où lui trouve cela opportun, mais de manière que ce soit bon pour nous aussi. C'est comme ça qu'il faut se préparer.
Tout le monde y a gagné ?
Il est en fonction depuis janvier, mais pour diverses raisons, j'ai avec lui une relation ancienne. Et dans ces cas-là, surtout pour un pays de la taille de la Hongrie, mais c'est vrai aussi pour des pays plus grands, une sorte de course s'engage : il faut aller le plus vite possible. Moi, j'ai choisi une autre stratégie. Puisque nous nous connaissons depuis longtemps, c'était notre sixième rencontre, je n'avais aucune raison de me précipiter. J'ai dit à mes collaborateurs : nous n'y allons que lorsque nous aurons un paquet d'accords important et sérieux. Parce qu'il y avait énormément de travail, énormément de dossiers à régler lors d'un tel entretien. Et j'ai dit : s'il faut un an, qu'il faille un an. Finalement, il n'a pas fallu un an, seulement huit ou neuf mois, mais j'ai exigé que tous les dossiers importants entre la Hongrie et les États-Unis soient mis sur la table, et qu'ils se concluent par un accord. Et à cela, comme vous le dites, est venue s'ajouter récemment une sanction américaine décidée en urgence, dont il nous fallait également nous dégager.
Si je vous posais la question de savoir si vous saviez à l'avance que vous obtiendriez l'accord pour l'exemption de sanctions, c'est parce qu'une semaine, ou peut-être quelques jours auparavant, le président Trump avait déclaré assez bruyamment à la presse qu'il n'y aurait aucune concession faite à la Hongrie.
Oui, à ce moment-là, je savais déjà que nous allions parvenir à un accord.
Donc malgré tout, vous saviez en y allant.
Je l'avais anticipé. Je ne le savais pas, je l'avais déduit. Si un homme d'affaires augmente les enjeux d'une négociation, c'est généralement qu'il veut conclure un accord, non ?
Je pensais que nous parlions de politique. Vous avez appris à fonctionner comme cela Vous y êtes habitué ? Parce que c'est un mode de pensée très différent de celui des hommes politiques d'autrefois.
Il y a des profils très différents, personne ne rentre dans le même moule. Lui, c'est… voyons, combien de présidents ai-je connus ? Le premier, en 1989, c'était le président Bush père, que j'ai rencontré ici, à Budapest. Le deuxième, Bill Clinton. Ensuite est venu le jeune Bush, puis le président Obama, avec eux, j'ai tous négocié. Puis il y a eu le président Obama, avec lui je n'ai jamais eu d'entretien bilatéral, mais nous nous sommes rencontrés et avons discuté lors des sommets de l'OTAN. Ensuite est venu le président Trump : je l'ai rencontré. Puis le président Biden.
Avec lui, non.
Et maintenant le président Trump à nouveau. Et si vous regardez l'ensemble…
Ce sont tous des personnalités très différentes.
Ils sont tous différents. Le président Trump, comme disent les Américains, est un maverick, un original, une catégorie à part. Mais les autres, chacun à l'intérieur de sa propre catégorie, sont aussi très différents. Négocier avec un Bill Clinton jeune et dynamique n'avait rien à voir avec des discussions avec le président Bush père. Ce sont deux mondes.
Et pendant les négociations…
Pardon ! Je veux simplement dire que la politique est un art fondé sur l'expérience. On peut élaborer des théories, c'est important, faire des analyses, c'est très important, mais au fond, seules comptent les situations que vous avez réellement vécues. C'est cela, le vrai savoir, c'est cela, la vraie valeur.
Ce que je voulais vous demander, et cela a d'ailleurs un lien direct avec ce que nous évoquions, c'est ceci : lorsqu'on se rend à une négociation avec quelqu'un comme Trump, un homme d'affaires, qui ne vient pas de la politique classique, est-ce qu'on peut, par exemple, faire valoir un argument du type : « J'ai besoin de cet accord, parce qu'il y aura des élections en Hongrie l'an prochain, et que cela ferait mauvais effet si je rentrais bredouille » ?
On doit argumenter dans ce sens-là, pas exactement ainsi, mais cela s'en rapproche. Disons que c'est comme cela qu'il faut entrer dans la négociation, mais ce n'est pas là qu'il faut arriver. Il faut savoir avec qui on peut ruser, avec qui on peut manœuvrer, avec qui on peut orienter le cours de la discussion pour qu'elle aboutisse là où vous voulez qu'elle aboutisse. Et il faut aussi savoir qu'avec certains, il n'y a aucune chance, inutile de tenter des subtilités : mieux vaut annoncer vos enjeux dès le début. Et c'était le cas ici. Je lui ai dit : « Écoutez, Monsieur le Président, si vous faites cela, vous détruisez la Hongrie. Moi ? C'est secondaire : ce qui se passera aux élections, ce n'est pas le sujet. Ce dont nous parlons ici, c'est que l'économie hongroise s'effondrerait. Regardez : c'est un pays enclavé, sans accès à la mer. Nous avons nos pipelines, ces deux-là, et il y en a de plus petits, complémentaires, mais rien de plus. Comment voulez-vous que je m'en sorte ? Si vous faites cela, lui ai-je dit, le prix de l'énergie va tripler pour chaque foyer hongrois, et une part considérable de nos entreprises fera faillite. Voilà l'enjeu, c'est de cela qu'il s'agit. »
Il vous a cru ?
C'est bien cela la situation. Là-bas aussi, il y a des gens qui réfléchissent.
Très bien, mais nous ne sommes pas le seul pays enclavé.
Ils ont leurs dossiers, leurs calculs. Si vous dites quelque chose qui est du bluff, on vous tire les oreilles, et vous avez perdu. Avec le président Trump, il ne faut surtout pas bluffer. Je le répète : c'est un homme d'affaires, il vous voit à travers en une seconde. Et c'est quelqu'un qui n'aime pas qu'on essaie de le tromper. Donc mieux vaut ne pas s'y risquer. Il faut être honnête : j'avais mes chiffres. Donc si, par hasard, il y avait eu une discussion pour savoir si c'était vrai ou non, j'aurais sorti mes trois chiffres. Mais lui aussi avait ces trois chiffres. Il n'avait aucune envie de se retrouver dans la situation où je devrais corriger ses données, et ensuite…
On s'assoit tout de même préparé à une table de négociation comme celle-là. Mais sur la question de l'exemption de sanctions, il y a un certain flottement dans les déclarations.
Oui.
Vous, vous avez dit que c'était un accord à durée illimitée, celui que vous avez conclu avec Donald Trump. Or la presse internationale, s'appuyant d'une part sur des sources de la Maison-Blanche, d'autre part sur le Département d'État, affirme qu'il s'agit d'un accord d'un an, qui serait pratiquement équivalent à ce qui nous attend dans l'Union européenne, où nous devrions de toute façon sortir des matières premières russes, gaz ou pétrole, d'ici fin 2027. Cet accord, est-il consigné quelque part ? Qu'est-ce qui définit exactement ce qui a été convenu ?
Nous nous sommes serré la main. Donc, comment cela fonctionne-t-il ? Le président m'a écouté, puis il a dit : « Je comprends, je vous l'accorde. » Et nous nous sommes serré la main. Cela signifie que tant qu'il est président là-bas, et que je suis Premier ministre ici, cet accord tient. Quand les conditions changent, il faut renégocier.
C'est d'ailleurs ce que dit Péter Magyar : si les conditions changent, il voudra renégocier.
Je lui souhaite bien du courage ! Ce que je peux dire, c'est que le président américain est le président, il ne dirige pas une institution bureaucratique. Il dit : « Très bien, nous nous sommes compris, nous sommes d'accord, ce sera ainsi, mettez cela en musique ». Donc il faut comprendre ceci : tant que lui est président là-bas, et que je suis Premier ministre ici, cet accord, absolument vital pour la politique hongroise de plafonnement des charges énergétiques, est en vigueur. Si cela dure vingt ans, alors il durera vingt ans.
Combien cela nous coûte-t-il ? Les économistes estiment qu'au cours des prochaines années, sur la base des promesses faites, nous dépenserons plusieurs milliers de milliards de forints aux États-Unis.
Oui, mais je reviens au point de départ : je n'ai rien offert en échange. Je ne voulais donc pas conclure un marché. J'ai dit au président : « Monsieur le Président, je vous en prie, comprenez notre position. Nous, les Hongrois, nous sommes dix millions, et voilà notre situation. »
Mais si c'est un homme d'affaires, n'a-t-il pas répliqué que sa compréhension serait facilitée si les États-Unis recevaient tel ou tel type de commandes ?
Non, il ne l'a pas dit. Il aurait pu, mais il ne l'a pas dit. Parce que, dans les affaires aussi, il n'y a pas que les intérêts : il y a la confiance, la loyauté, le partenariat à long terme. Et il a estimé qu'il n'avait rien à demander en échange, et il n'a rien demandé. De toute façon, je n'aurais rien donné.
Ce que nous donnons…
De toute façon, je n'aurais rien donné.
Rien du tout ?
Comment l'aurais-je pu ?
Disons qu'on calcule l'ampleur du dommage que subirait l'économie hongroise si cet accord n'existait pas. Donc on sait jusqu'où on peut aller, et que je peux consentir à un effort équivalent, ou légèrement inférieur. Ainsi, nous y serions encore gagnants.
Oui, mais…
C'est du business, non ? Du business.
Mais je jugeais impossible que la situation se présente ainsi. J'ai noué une amitié avec le président des États-Unis à l'époque où il était au plus bas. Rappelez-vous : il a perdu l'élection. Et même la première, il ne l'a pas gagnée ; moi, déjà à ce moment-là, je le soutenais. J'ai été le seul Européen à oser dire que le monde s'en porterait mieux si le prochain dirigeant des États-Unis s'appelait Trump et non Hillary Clinton. Personne d'autre ne l'a dit ! Et lorsqu'il a perdu l'élection, j'ai été le premier à l'appeler, pas le nouveau président. Parce qu'il y avait une relation d'amitié entre nous. Et j'ai pensé que si jamais, par sa décision, involontairement, car c'était involontaire, il mettait un pays ami dans une situation impossible, alors il saurait le reconnaître : il ne demanderait rien pour revenir sur cette décision, mais il dirait : « je comprends, vous serez exemptés, vous ne perdrez rien. » Et je pense que c'était juste. Bien sûr, les proportions sont différentes, mais moi aussi, j'aurais agi ainsi, si je puis me permettre de le dire.
Dans la communication officielle du Département d'État américain, je l'ai noté, il est indiqué qu'au total, pour l'équivalent de 7 000 milliards de forints, nous allons acheter une centrale électrique, du combustible pour cette centrale, du GNL et du matériel de défense.
C'est plutôt une fourchette, il faut le comprendre ainsi. Il n'y a pas de somme fixe et déterminée. Nous avons établi une coopération dans différents domaines, et cette coopération a des conséquences financières, je le formulerais plutôt comme cela. Mais ce que vous avez mentionné n'inclut pas, du moins pas tel que vous le dites, le fait qu'en réalité, des investissements américains vont arriver en Hongrie.
Oui, mais cela, le Département d'État ne l'a pas écrit. Évidemment que le Département d'État ne peut pas l'écrire.
Quel département d'État ?
Celui des États-Unis !
Moi, j'ai discuté avec le président Trump.
Je comprends, mais les Américains ont tout de même écrit le reste…
Mais je ne suis pas certain que…
…et pas cela.
Oui, mais je ne suis pas sûr que vous saisissiez, pardonnez-moi, car c'est une logique particulière ; ce n'est pas simple à comprendre, ce n'est pas naturel pour nous. Ce que je veux dire, c'est que peu importe ce que rédige le Département d'État. C'est un système présidentiel. Le Département d'État, comme n'importe quel ministère, exécute la mise en œuvre technique. Le président dit : « Voilà ce que je veux, ce sera ainsi », et eux doivent trouver la manière de le réaliser. C'est pourquoi l'important, c'est ce que dit le président, pas ce que les services écrivent.
C'est aussi comme cela que fonctionne le gouvernement hongrois ?
Non. Le gouvernement hongrois ne fonctionne absolument pas comme cela, parce que nous sommes dans un système parlementaire. Notre modèle est différent ; le leur est un système présidentiel. Pas même semi-présidentiel…
Est-ce qu'il vous plaît ?
…comme en France.
Est-ce que ce modèle vous plaît ?
Cela dépend des pays. En 2010, quand nous avons obtenu la majorité des deux tiers pour la première fois, j'ai eu de nombreuses discussions très passionnantes. J'ai surtout écouté les anciens, les « grands anciens », au premier rang desquels János Martonyi. Nous savions que, puisque nous avions les deux tiers, il fallait rendre l'État plus efficace, se débarrasser d'un certain nombre de lourdeurs. Nous savions aussi que nous n'avions pas de véritable Constitution, seulement une Constitution provisoire : l'ancienne Constitution se qualifiait elle-même d'intérimaire. Or on ne vit pas à titre provisoire. On veut se tenir sur des bases solides, connaître ses valeurs, ses objectifs, les finalités de l'État, tout cela devait être consigné. De plus, nous avons une identité culturelle, nationale et chrétienne très forte ; il était donc clair qu'il nous fallait une Constitution nationale et chrétienne. Mais restait la question du système de pouvoir. Tout cela, nous le savions ; je n'avais pas besoin de passer des heures ou des jours pour trouver les bonnes réponses. L'autre question, en revanche, était de savoir comment structurer le système institutionnel, ce qui convient aux Hongrois, et ce qui ne leur convient pas. Enfin, ce n'était pas là où je voulais en venir…
Vous auriez eu envie d'un système présidentiel ?
C'était ma question, c'est là où je voulais en venir. J'ai dit : « János, nous avons maintenant l'occasion. Faut-il passer à une forme de système présidentiel, ou à un système de type régence, rappelant celui de l'époque Horthy ? Ou bien, devons-nous nous inspirer des systèmes présidentiels que l'on trouve aujourd'hui en Europe : en Roumanie, en France, ou désormais en Turquie ? Est-ce une voie que nous devrions envisager ? » Et au terme de longues discussions très stimulantes, plutôt intellectuelles, relevant de l'histoire politique, nous avons conclu que le système parlementaire est celui qui nous convient. La question n'est pas de savoir quel modèle est théoriquement le meilleur, mais de savoir ce qui, ici et maintenant, correspond à nos réalités culturelles, et au savoir que nous possédons. Car la politique, c'est aussi une connaissance : savoir comment faire fonctionner une machine très complexe. Et la structure de cette machine est complètement différente selon qu'on se trouve dans un système présidentiel ou dans un système parlementaire. Nous avons donc décidé de ne pas y toucher. Et même si nous avons obtenu les deux tiers encore et encore, j'ai toujours reposé la question : « Notre avis a-t-il changé ? » Et ils ont répondu : « Non, restons dans le parlementarisme. »
Quand était-ce la dernière fois ?
Il y a quatre ans. Je pose toujours la question : « Nous avons une majorité des deux tiers, devons-nous modifier le système de pouvoir ? » Parce que la politique se construit sur l'expérience. Vous gouvernez quatre ans, puis huit, puis douze : vous apprenez des choses. De nouvelles questions surgissent sans cesse. Et alors, il faut tout réexaminer. L'Église doit toujours être réformée : c'est la bonne attitude pour la politique aussi. Il faut toujours vérifier. La toute première longue discussion a abouti à la décision de rester dans le cadre constitutionnel actuel et de ne pas aller vers un système présidentiel. Et lors des victoires suivantes, nous avons chaque fois conclu automatiquement : « Cela fonctionne, n'y touchons pas. » Mais la question reste toujours sur la table. Je recommande d'ailleurs aux Hongrois de ne jamais considérer ces sujets comme définitivement clos. La vraie question est : ici et maintenant, avec notre histoire, nos connaissances, et les défis auxquels nous faisons face, qu'est-ce qui est le meilleur pour les Hongrois ? C'est cette question qu'il faut poser. Et il faut la poser en permanence.
Revenons un instant aux États-Unis. Y avait-il de la part de vos hôtes certaines attentes, des commandes, des dossiers, du type : « Nous sommes amicaux envers vous, mais achetez donc chez nous, par exemple des armes, ou du GNL » ?
Ça existe depuis très longtemps. Il y a toujours des demandes de ce genre, de la part de tout le monde, simplement, les Américains sont grands. Mais où que j'aille en Europe, c'est pareil.
Chacun essaie de vendre quelque chose, évidemment.
Bien sûr ! Pardon, et moi aussi. Très bien, c'est normal, mais…
Qu'avons-nous pu vendre, nous, cette fois-ci ?
Très souvent, nous vendons par exemple des capacités en technologies de l'eau. Dans ce domaine, nous sommes très bons. L'économie hongroise n'est pas compétitive dans tous les secteurs, mais il y a des domaines où nous avons un réel avantage. Ou encore, cela a peu attiré l'attention du public, pour une raison ou une autre, ces dernières années, nous avons acheté des champs gaziers. Nous n'en avons pas nous-mêmes, alors il faut en acheter…
Au Moyen-Orient.
En Asie centrale, oui. Et aussi des champs pétroliers. Donc je réfléchis beaucoup à ce dont les Hongrois ont besoin, c'est cela que je regarde. Parfois je veux vendre, parfois acheter. Je veux améliorer la position de l'économie hongroise. Tout le monde fait comme cela. C'est également le cas des Américains, et des sujets sont sur la table depuis longtemps. Certains, nous les acceptons ; d'autres, nous les refusons. Parce qu'il ne faut jamais acheter quelque chose seulement parce que l'autre veut vous le vendre. Nous sommes à Budapest : il y a ici une culture commerciale, on sait comment cela fonctionne.
Mais du gaz, nous avons dû en acheter, semble-t-il.
Il faut toujours acheter de manière que cela vous soit favorable. Si vous achetez du gaz, vous devez savoir à qui vous n'en achèterez plus ensuite. Parce que nous consommons une quantité donnée. Si vous en achetez à l'un, vous en prendrez moins chez un autre. Donc celui à qui vous achetez doit être à un prix inférieur à celui dont vous vous détournez, pour que vous y gagniez au final. C'est comme cela qu'il faut faire.
Et c'est ainsi aujourd'hui ?
Bien sûr !
Donc nous recevons du gaz russe à un prix plus élevé que si nous en prenions d'un autre terminal ?
Non, nous n'achetons pas seulement aux Russes : nous achetons au Qatar, à l'Azerbaïdjan, à la Russie. La Hongrie a diversifié son système d'approvisionnement. En dehors de la Slovénie, nous avons des réseaux de pipelines de moindre ampleur dans toutes les directions. Il y a partout quelque chose : soit un réseau électrique, soit un réseau gazier. La Slovénie est la seule direction par laquelle nous ne pouvons pas atteindre l'Italie, les négociations y sont toujours difficiles. Pour l'électricité, nous sommes déjà plus avancés, mais pour le gaz, je n'ai jamais réussi à me mettre d'accord avec eux. Eux aussi ont leurs raisons, il faut en tenir compte. Ils ont même organisé un référendum contre nous, d'une certaine manière, si vous vous en souvenez, il y a quelques années. Vous ne vous en souvenez pas.
C'est vous qui négociez cela, ou bien le groupe Mol ?
Cela dépend. Nous avons deux possibilités. À Budapest, il faut être malin. Selon les situations, nous mettons l'un ou l'autre en avant. Nous avons MVM, une entreprise 100 % publique. Parfois, c'est elle que nous poussons en première ligne. Et à d'autres moments, quand je vois que nos interlocuteurs ne veulent voir que des entreprises privées, alors c'est le groupe Mol qu'il faut envoyer. Je dis à Mol : « Voici une opportunité. Ça vous intéresse ? » S'ils répondent non, très bien. S'ils répondent oui : « Allez-y. J'ouvre la porte, foncez. »
Très bien, nous n'avons pas réussi avec les Slovènes, mais revenons à ce dossier américain.
Concernant le gaz.
Est-ce que, finalement, cela revient moins cher ?
Oui, ce n'est pas énorme, d'abord. Nous achetons pour cinq ans, si je me souviens bien, 400 millions de mètres cubes par an, ce qui fait deux milliards au total. Pour un an, pas pour cinq ans, donc nous avons acheté deux milliards pour cinq ans, et il nous faut au total 45 milliards. Il faut comptabiliser comme cela.
Il y a quelques années, nous entendions Péter Szijjártó dire que la solution américaine, en matière de technologie nucléaire, n'était en rien meilleure que la russe et, de surcroît, ne s'intégrait pas dans notre système. Et maintenant, voici un accord américain. Est-ce eux qui ont changé, ou est-ce nous qui avons changé d'avis ?
Ce sont deux choses différentes, lorsqu'on parle d'énergie nucléaire. Ils ont une technologie dans laquelle ils sont meilleurs que nous : c'est le stockage du combustible nucléaire usé. C'est l'une des questions les plus importantes, peut-être la plus importante, de toute l'industrie atomique, juste après l'exploitation elle-même. C'est une question de point de vue, donc nous utilisons…
D'un point de vue environnemental, c'est certainement l'enjeu majeur : il faut bien en faire quelque chose.
Oui, mais d'un point de vue environnemental, il est aussi important que l'énergie nucléaire pollue moins que les fossiles. Au bout du compte, tout devient une question écologique. Enfin bref, ce sont des sujets complexes. Ce que je veux dire, c'est que la technologie américaine permettant de conserver, dans des conditions sûres, les éléments combustibles usés, qui présentent encore des processus isotopiques, une radioactivité, est meilleure que ce que nous avons aujourd'hui. Nous avons donc acheté une technologie supérieure. On ne peut jamais tout optimiser à cent pour cent, mais mon principe directeur, celui que je m'efforce d'appliquer, c'est que nous devons acquérir ce qui se fait de mieux. Si nous achetons quelque chose, achetons le meilleur. Ce n'est pas toujours possible, je pourrais donner des exemples, mais lorsque c'est possible, il faut viser la technologie de pointe. C'est le cas ici. Le combustible, c'est autre chose. Le stockage du combustible usé est un sujet distinct. Et il existe un autre accord prévoyant que nous achèterons aussi du combustible américain. Il y a deux questions, en réalité. La première : il est préférable d'avoir une centrale nucléaire capable d'accepter plusieurs types de combustibles. Nous avons actuellement une technologie russe combinée à une technologie française, ce qui est déjà mieux qu'avant, et maintenant s'ajoute une technologie américaine. Pendant des années, j'ai demandé à la compagnie électrique de me répondre clairement : dans une centrale conçue avec une technologie russe, quel autre combustible peut-on introduire sans risque de sécurité ? Parce que la politique est un métier fondé sur l'expérience : j'ai déjà vu des cas où l'on introduisait un combustible différent dans une centrale de type russe, et cela provoquait un incident. Cette question fait l'objet d'une étude depuis de nombreuses années. Avant mon voyage aux États-Unis, j'ai demandé : « Où en êtes-vous ? » Ils m'ont répondu : « Ce que propose aujourd'hui Westinghouse est sûr, nous pouvons l'utiliser. » Donc maintenant : russe, français, américain - voilà notre situation.
Avec ce soutien manifeste de Donald Trump en faveur de votre campagne de l'an prochain, c'était évident : ce qu'il a dit, la façon dont il vous a reçu, dont il vous parlait, la manière dont vous étiez assis à ses côtés, la scène était spectaculaire. Mais quelque chose d'autre est spectaculaire : on dirait que la politique hongroise commence lentement à changer de cap.
Si vous permettez, arrêtons-nous un instant.
Je vous en prie !
Parce que l'élection est importante, certes, mais il y a une vie avant et après l'élection. Il ne faut pas confondre l'ordre des priorités. Dans les relations américano-hongroises, la question n'est pas de savoir si le président américain me soutient, ni quel impact cela peut avoir sur les élections. La question, c'est : qu'est-ce qui est bon pour les Hongrois ? Et ce qui est bon pour les Hongrois, c'est que les États-Unis, encore aujourd'hui la première puissance mondiale, entretiennent une bonne relation avec la Hongrie, une relation amicale, et si possible profondément amicale. C'est cela qui est bon pour les Hongrois. L'élection vient seulement après.
Dans quelle mesure cette relation amicale est-elle personnelle ?
Toujours, en Amérique, c'est toujours personnel.
L'autre aspect de ma question, c'est que ces dernières années, vous avez été très critiqué, et la politique hongroise a été très critiquée, à cause de la dépendance perçue envers la Russie dans tous les domaines : politique, économique, et surtout énergétique. Et aujourd'hui, on dirait qu'il y a un changement. Avec ce partenariat américain, ces accords, ce partenariat français, on a l'impression que ce grand navire qu'est la politique hongroise avait commencé à changer de cap.
Non, non.
Non ?
Je n'aime pas procéder ainsi, ce n'est pas mon style. S'il y a un barreur, ou plutôt quelqu'un perché en haut du mât, c'est pour voir ce qui va arriver.
D'accord, mais si celui-là crie, alors le capitaine tourne la barre.
Oui, oui… mais on ne s'affole pas. Ce que celui qui est dans le nid-de-pie aperçoit trop tard, cela, c'est un problème. Donc il faut y mettre quelqu'un qui n'a pas besoin de lunettes, qui voit bien. S'il est là-haut, c'est pour dire : les enfants, dans trois ans, dans quatre ans, dans dix ou quinze ans, les choses seront différentes. Donc, pas d'agitation, pas de brusques mouvements de barre dès maintenant ; on avance calmement. Et même si l'on rectifie la trajectoire, on ne prend pas des virages serrés, pas d'épingles à cheveux. On avance tranquillement, progressivement.
Mais donc, on modifie la direction, en ce moment ?
Nous avons une opportunité. Qu'aurais-je pu faire avec le président Biden ? Imaginez la situation ! Qu'aurais-je pu obtenir de lui ?
Peut-être, avec une proposition commerciale, on aurait pu frapper à sa porte, qui sait…
Vous en souvenez-vous ainsi ?
Ni vous ni lui n'avez pu le tester.
Il y a des situations, des occasions : ce qu'on appelle dans le métier des fenêtres qui s'ouvrent. Un moment se crée, quelque chose s'ouvre, et il faut saisir ce moment. Là, une fenêtre s'est ouverte : c'est une opportunité, et les opportunités doivent être utilisées. Pour ce qui est de la dépendance, je serais plus prudent que ce que votre formulation laisse entendre. D'abord, nous n'avons aucune dépendance politique envers la Russie. Nous avons une dépendance historique. Ce n'est pas la même chose. Ils sont là, nous sommes ici ; Moscou est là-bas, Berlin ici, Istanbul là-bas. On peut appeler cela une dépendance, mais je préfère dire : une donnée historique. Les Russes ne peuvent pas influencer les décisions politiques hongroises. Les décisions du gouvernement hongrois, nous les prenons nous-mêmes, sur la base des considérations hongroises. Dans nos calculs…
Il n'y a jamais eu de moment où…
Non.
…où ils ont essayé d'exercer une influence ?
Non. Le président actuel ?
Oui.
Non. Écoutez, en 2009, je me suis entretenu avec lui… Notre histoire, je ne sais pas si cela vous intéresse ?
Absolument ! On vous reproche d'avoir conclu un accord avec Poutine en 2009.
Oui. Mais ce n'est pas une accusation : c'est une reconnaissance.
Vous l'avez entendu mille fois, vous aussi : Poutine doit certainement détenir quelque chose sur Orbán, pour qu'il accepte tout.
Et pourquoi pas l'inverse ? Peut-être que moi, je sais quelque chose sur lui ! Mais laissons cela de côté pour l'instant.
Oui.
C'est une absurdité !
C'est peu plausible.
Oui, mais c'est plutôt un complexe d'infériorité, enfin, bref. Non. Jusqu'en 2008, je pensais que cela avait un sens que le monde occidental avance vers l'Est et stabilise un maximum de pays. C'est ce qui nous est arrivé. L'effondrement du socialisme n'est rien d'autre que cela : l'avancée vers l'est du monde occidental et de ses alliances, l'Union européenne et l'OTAN. Nous aussi, nous avons été une zone tampon, comme les Ukrainiens aujourd'hui. En 1990, les Russes sont partis.
Bien sûr.
Nous sommes sortis du Pacte de Varsovie, nous n'étions pas encore dans l'OTAN, c'est ce qu'on appelle une zone tampon. Mais grâce à plusieurs Premiers ministres, nous avons réussi à nous extraire de cette situation, à saisir l'occasion que l'Histoire nous offrait, et nous avons stabilisé la Hongrie. Nous sommes entrés dans l'Union européenne et dans l'OTAN. Jusqu'en 2008, je pensais que ce processus pouvait se poursuivre géographiquement. Mais entre 1990 et 2008, les Ukrainiens ne sont pas parvenus à se renforcer suffisamment, et aucune unité occidentale ne s'est formée pour ancrer l'Ukraine dans le camp occidental. Je ne sais pas si vous vous en souvenez : c'était en 2008, peut-être 2007, au sommet de l'OTAN à Bucarest.
La question de l'adhésion de l'Ukraine…
De son adhésion à l'OTAN…
Oui.
…à l'OTAN. Les États-Unis soutenaient cette adhésion, les Européens, non. Les Européens ne voulaient pas. Et là, j'ai compris que tout cela était terminé. Les Européens ne l'ont pas soutenue, justement parce qu'ils sentaient que la Russie était déjà trop forte. Si nous faisions ce pas-là, cela entraînait un conflit. À partir de ce moment-là, j'ai compris que l'expansion occidentale vers l'Est était terminée. Et que les Russes s'étaient renforcés, qu'ils resteraient ici, qu'ils deviendraient une puissance mondiale, et qu'il faudrait compter avec eux, que cela nous plaise ou non.
C'est cela qui a servi de base à l'accord de 2009 ?
C'est pour cela que je suis allé là-bas en 2009. En Russie aussi, il vaut mieux jouer cartes sur table. Dans un système présidentiel, à la différence des systèmes parlementaires, où il y a plus d'espace pour manœuvrer, il vaut mieux parler franchement, surtout quand on est un pays de notre taille. Je suis donc allé là-bas en 2009, et je me suis entretenu avec le président. Je lui ai dit que j'allais gagner les élections, pardon pour l'arrogance, mais en 2009 ce n'était pas un pari risqué…
C'était évident, oui…
Oui. Je lui ai dit : « Il semble que je dirigerai le gouvernement hongrois à partir de 2010, et vous serez le président de la Russie. Voilà la situation. Je vois ce qui se passe : cette expansion-là est terminée. Et je voudrais mettre une question sur la table : comment pouvons-nous coopérer ? Avez-vous un plan ? Moi, j'en ai un. Essayons de parvenir à un accord. » Et nous avons défini les cadres de cette coopération. Par exemple, nous ne remettons pas sur la table les questions historiques, chacun pense ce qu'il veut, les historiens trancheront. Je n'ai pas l'intention de discuter par exemple, de 1956 : cela ne mènerait nulle part. Deuxième point : une ligne directe. C'est-à-dire que, si un sujet important apparaît et qu'il faut parler directement, nous pouvons le faire.
Cette ligne existe-elle encore aujourd'hui ?
Oui, c'est toujours en place. Troisième point : nous nous rencontrons une fois par an. Ainsi, la relation est transparente : un sommet annuel, soit en Russie, soit à Budapest. Nous avons procédé ainsi jusqu'à l'arrivée du régime de sanctions. Chaque année, nous examinions où nous en étions, quels étaient les problèmes, il y en a toujours, surtout avec les Russes, et nous réglions cela au niveau le plus élevé, puis les équipes travaillaient dessus pendant un an, et nous y revenions ensuite. J'ai donc instauré un système transparent, lisible. J'ai une vision claire du rôle que joue aujourd'hui la Russie, du rôle qu'elle jouera dans les quinze à vingt prochaines années dans l'histoire de l'Europe et dans l'histoire des Hongrois. Et je veux tirer le meilleur parti possible de cette donnée.
Revenons aux États-Unis, à ce bouclier protecteur.
Je voulais juste apporter des précisions au mot « dépendance ».
Je comprends, et je pense que c'est clair. Mais cette histoire de bouclier reste un peu flou. Tout le monde essaie de l'expliquer, alors que c'est vous qui l'avez négocié.
Le plus simple, c'est que vous me posiez la question.
Exactement ! Alors : quel montant, quelles conditions, et quand pouvons-nous y recourir ? Quand devons-nous y recourir ?
Nous n'avons pas besoin d'y recourir. Nous pouvons le faire quand nous voulons, et sous la forme que nous voulons.
Qu'entendez-vous par forme ?
Il existe plusieurs instruments internationaux. Je peux citer des mots comme swap line, flexible credit line, etc. Certains outils sont utilisés entre banques centrales pour stabiliser une monnaie donnée. D'autres sont utilisés non par les banques centrales mais par les gouvernements. C'est ce type de dispositif que possède aussi l'administration américaine. Je me suis mis d'accord avec le président, là encore, on s'est serré la main, sur ceci : si la Hongrie rencontre une difficulté financière, nous pouvons utiliser l'un des outils internationaux reconnus, transparents et disponibles, celui qui sera le plus adapté à ce moment-là. Mais bien sûr, il faudra que je renégocie avec lui avant de l'activer. L'accord, c'est que la Hongrie ne peut pas se retrouver dans une situation financière susceptible de mettre son économie en difficulté. Dans ce cas-là, les États-Unis, ou plutôt le président, seront derrière nous et nous aideront.
Y a-t-il un plafond ?
Non. Mais il ne faut pas une grande imagination pour estimer la somme dont nous aurions besoin pour assurer notre stabilité : 10 à 20 milliards de dollars ou d'euros. Vu depuis les États-Unis, ce n'est pas un montant significatif. Les Argentins, confrontés à une grave crise monétaire, ont utilisé un instrument gouvernemental de 20 milliards. Notre monnaie est stable : nous n'avons pas besoin de ce type d'outil, mais il est disponible. Nous avons déjà chargé les équipes de travailler sur ces outils, pour déterminer lequel serait le meilleur et quand l'utiliser. Donc un tel travail est en cours…
Nous sommes donc dans une situation économique aussi grave ?
Toujours. La Hongrie, toujours.
Bon, depuis que j'ai l'âge de comprendre, ça a toujours été ainsi…
Même avant.
Probablement, mais aujourd'hui, le problème est-il aussi grave que cela ?
Depuis la Première Guerre mondiale, la Hongrie a toujours été en difficulté. Qui ne le sait pas ne connaît pas l'histoire hongroise. En raison de sa taille et de sa situation géographique particulière, la Hongrie affronte en permanence des difficultés, et beaucoup dans le monde la considèrent comme une cible. Nous avons toujours des amis, et toujours des adversaires. Et, dans le monde moderne, ces luttes se mènent aussi par des moyens financiers. Depuis que la Hongrie historique a disparu et que nous vivons dans la « petite Hongrie », notre pays a constamment dû affronter des problèmes financiers. Si vous remontez au gouvernement Bethlen, entre les deux guerres, le plus grand succès a été la stabilité financière. On peut aussi évoquer la figure, controversée mais talentueuse, de János Fekete : lorsque les problèmes surgissaient, il fallait bien utiliser ces réseaux. La Hongrie est un pays que j'aimerais voir devenir créancier, c'est l'un de mes rêves, ou disons : l'un de mes objectifs stratégiques.
Cela a déjà été tenté, et cela a mal tourné : nous avions prêté à des pays africains…
Oui, oui, mais il faut regarder l'ensemble. Je voudrais que notre pays soit un pays qui prête à d'autres, et qui ne soit plus obligé d'emprunter. Mais nous en sommes très loin.
Si je comprends bien, ce ne sera pas pour maintenant.
Oui, mais j'y travaille.
Mais cet accord vise-t-il à créer une réserve de sécurité parce que le budget est en difficulté ?
Non, il n'y a aucun lien. Je le répète : depuis la fin de la Première Guerre mondiale, la Hongrie…
Oui, j'ai compris.
…a toujours eu besoin d'un bouclier financier. Parfois nous avons réussi à en créer un, parfois non. Là, nous y sommes parvenus.
Les fonds européens ne pourraient-ils pas jouer ce rôle ?
Ils pourraient, mais ils ne sont pas de cette nature. Là, la banque centrale est séparée de l'Union européenne. Pour stabiliser une monnaie, ce n'est pas Bruxelles qu'il faut voir, mais Francfort. Nous avons d'ailleurs toutes sortes de coopérations avec eux. Si un jour quelqu'un écrit l'histoire financière moderne de la Hongrie, il verra qu'il y a eu de bonnes périodes dans la relation entre la BCE et la Banque nationale hongroise, et des périodes plus difficiles. Donc ce dossier se traite plutôt là-bas. Mais globalement, aujourd'hui, nous ne pouvons pas compter sur Bruxelles. Bruxelles regarde la Hongrie d'un œil hostile et ne veut pas nous soutenir.
La Hongrie ou votre gouvernement ? Ce n'est pas la même chose. Qu'en pensez-vous ?
Pour le moment, les deux coïncident.
Pas totalement.
Si, totalement.
Il y a le pays et il y a le gouvernement : ce n'est pas la même chose.
Oui, mais c'est au nom du pays que je négocie à Bruxelles. Qu'on le veuille ou non, ici comme là-bas, c'est ainsi. Aujourd'hui, personne d'autre ne peut représenter les intérêts de la Hongrie, à part moi.
Mais comment cela peut-il être perçu ? « On ne donnera pas d'argent aux Hongrois » ou « On ne donnera pas d'argent à Viktor Orbán » ?
C'est ce que j'essaie d'expliquer : aujourd'hui, c'est la même chose. C'est la situation, non ?
Pas tout à fait.
Alors regardons de nouveau : s'ils n'en donnent pas, ils n'en donnent pas.
D'accord.
Le prétexte est-il important ? Ils ne donnent pas d'argent.
Si vous regardez les choses ainsi, vous avez raison.
Mais c'est à moi de résoudre ce problème. Que mes yeux ne leur plaisent pas, ou que les Hongrois aient voté non à la migration lors du référendum, c'est secondaire. Le fait est que Bruxelles nous considère aujourd'hui, mon gouvernement, comme un obstacle à ses objectifs.
Et c'est cela que compense l'accord avec le président Trump ?
Oui. Dans le sens où nos difficultés avec Bruxelles augmentent notre vulnérabilité financière, tandis que notre bonne relation avec les États-Unis l'améliore. Elles se compensent.
Une dernière question sur les États-Unis, puis je laisse ce sujet, il y a encore beaucoup d'autres choses…
Non, c'est passionnant, allez-y…
Le président Trump viendra-t-il à Budapest, indépendamment du fait que le sommet Trump-Poutine ait lieu ou non à Budapest ?
Avec la précision que vous venez d'ajouter, je ne peux pas répondre oui. Ce que je peux dire, en revanche, c'est qu'un sommet russo-américain est à l'ordre du jour à Budapest : une grande conférence de paix à Budapest, qui prend du retard. Mais le hongrois est une bonne langue : ce qui tarde n'en vient pas moins. Simplement pas au moment où nous le souhaiterions, mais un peu plus tard. Donc ce n'est pas impossible, disons-le ainsi. L'accord russo-américain n'est donc pas hors de portée : les délégations continuent à négocier. Nous sommes, dans une certaine mesure, impliqués : nous savons certaines choses, nous voyons les progrès, nous savons aussi où cela bloque et ce qu'il faudrait changer. Dans ma relation avec les Russes, j'essaie d'être utile dans la direction d'un accord. Je n'ai pas abandonné la mission de paix. Ce n'est pas le plus important pour l'instant…
Et où cela coince-t-il ?
À présent, cela bloque sur la question territoriale. Cela n'a pas toujours été le cas, mais aujourd'hui, oui.
Qu'exigent les Russes, et jusqu'où les Ukrainiens sont-ils prêts à aller ?
22 % de la région de Donetsk ne sont pas encore sous occupation russe. Et les Russes, après l'échec de la malheureuse négociation d'Istanbul en avril 2022, qui était pourtant proche d'aboutir, ont inscrit dans leur Constitution leurs revendications territoriales. En avril 2022, il y avait un projet d'accord russo-ukrainien sur la table : je l'ai vu de mes propres yeux…
Oui, rétrospectivement, tout le monde dit que c'était l'occasion.
Je l'ai vu, peu importe ce que j'ai vu ; ce qui compte, c'est que nous étions proches d'un accord. Cet accord a été détruit. Ce ne sont pas les Ukrainiens qui l'ont détruit, mais les Anglo-Saxons. Et, en réaction, les Russes ont dit : « Très bien, alors au lieu de deux régions, nous en prendrons quatre. » Car à l'époque, il n'était question que de Louhansk et Donetsk. Ils ont donc décidé d'en ajouter deux autres. Et ils ont inscrit cela dans leur Constitution. Et tant qu'ils ne les auront pas conquises, les Russes ne veulent pas conclure la paix, parce qu'ils pensent que le temps joue pour eux, et qu'ils sont en position favorable. J'essaie de leur fournir des arguments pour leur montrer qu'une victoire peut aussi se définir autrement. Il y a là une différence de poids, de logique : la logique d'un pays en guerre n'est pas la même que celle d'un pays qui veut la paix de l'extérieur. Il ne s'agit pas d'une guerre sur le papier : ce ne sont pas des tigres de papier. Ce sont deux armées très puissantes, qui se font subir chaque jour des pertes graves. Chaque jour, cela signifie des centaines, parfois des milliers de veuves, d'orphelins, de parents qui enterrent leurs fils, des choses terribles. En plus, ce sont deux pays slaves. Les Slaves sont réputés pour être de bons soldats, et assez impitoyables quand il faut faire la guerre. Ils sont déterminés, pour le dire de manière plus positive : ils sont résolus. C'est une guerre sanglante, dure, douloureuse, avec des conséquences civilisationnelles. On oublie trop souvent que ce sont des chrétiens qui s'entretuent, en Europe de l'Est, en Europe, alors même que nous craignons l'islamisation. Stratégiquement, cela n'a aucun sens : si quelque chose nous menace et que nous voulons nous y opposer, pourquoi affaiblir notre meilleur atout ? Pourquoi tuer des chrétiens ou laisser des chrétiens s'entre-tuer ? Ce que je veux dire, c'est que cette guerre n'est pas seulement incohérente sur le plan financier ou tactique : elle est incohérente pour l'avenir stratégique de l'Europe. Car notre intérêt serait que personne ne meure en guerre, commençons par là, mais en particulier qu'aucun chrétien ne meure sur un continent qui manque déjà de chrétiens.
Péter Szijjártó a dit qu'il avait discuté avec le président Trump de la paix, et que la Hongrie avait un plan. Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, a répondu que Moscou ne connaissait pas votre plan de paix.
Oui, ce n'est pas nécessaire qu'ils le connaissent officiellement. La Hongrie ne doit pas revendiquer, chercher à obtenir ou exiger la position du pays dont l'initiative conduirait à la paix.
Nous sommes trop petits ?
Oui, c'est essentiellement une question de poids.
Évidemment. C'est clair.
Sur le plan moral, nous sommes solides, la tête est en ordre, à ce niveau-là, nous sommes compétitifs.
Tout de même, ce n'est pas aux Hongrois de dire…
En effet, être une puissance, c'est un poids. Il faut savoir où est sa place.
Mais alors, quelles chances avons-nous de pouvoir avancer cette question ?
Nous discutons avec le président des États-Unis et nous parlons de la manière dont nous voyons la situation. Il pose des questions, nous répondons. Nous mettons certains points sur la table, avec le tact nécessaire, surtout pas d'arrogance. Et c'est la même chose avec la Russie. Quand je négocie ou discute avec le président Poutine, je lui soumets des arguments. Je l'écoute. Je pose davantage de questions que je ne parle.
Ce que M. Trump vient de dire, vous l'avez déjà transmis au président Poutine ? Vous lui avez envoyé ce genre de message ?
Je n'en ai pas le mandat, et si je l'avais, je ne pourrais pas vous en parler. Nous verrons bien.
Je vois. Vous avez, vous aussi, une casquette dédicacée par le président Trump ?
Pourquoi ? Moi ? Depuis 2015.
J'y ai réfléchi, j'ai regardé cette photo… Est-ce que ce n'est pas un peu gênant, comme on dit, un peu « cliché », d'être planté là en attendant que le président vous signe une casquette ?
Non.
Tout de même, c'est l'autre président qui attend à côté, enfin voyons…
Non. Regardez bien. La question n'est pas de se tenir là, mais comment on s'y tient. On est bien placés.
On est bien placés ?
Lázár aussi, moi aussi, nous sommes bien placés.
La station spatiale hongroise a également été annoncée, ce qui, d'une certaine manière, prête à sourire : ce ne sera pas une station hongroise à proprement parler, mais une participation au programme de la société Voyager, à laquelle nous apportons financement, technologie et savoir-faire.
Attendez, attendez. De quoi parlons-nous exactement ?
On a annoncé qu'il y aurait une station spatiale hongroise, mais il n'y en aura pas. La Hongrie a signé un accord avec Voyager, une entreprise privée.
Attendez, ne mélangeons pas tout.
Non, il ne faut pas, en effet.
Donc, on parle d'un satellite ?
Non, d'une station terrestre.
Ah, d'accord, c'est autre chose. Parce ce qu'il s'agit bien un satellite hongrois. Pardon.
Pour cela, nous nous sommes déjà enregistrés, je crois qu'il y a eu des informations à ce sujet ces derniers jours.
D'abord, nous en avons le droit, commençons par là. Dans le monde moderne, non seulement la Terre est répartie, mais le ciel aussi. Chaque pays a un secteur du ciel, un « espace orbital », où il est autorisé à placer un satellite. Il y a les orbites basses et les plus hautes.
Ce serait simple de dire : ce qui est au-dessus de nous nous appartient.
Vous devriez entrer en politique.
Il ne manquerait plus que ça !
Ce serait effectivement la solution. On n'en est pas si loin, d'ailleurs : il y a beaucoup d'irrationalité en politique, mais tout n'y est pas absurde. Et nous avons une très bonne position orbitale, un très bon droit de satellite. Mais un satellite coûte extrêmement cher, ces satellites Strato, et les gouvernements précédents n'ont jamais pu exploiter cette possibilité. Nous avons donc conclu un accord international, essentiellement avec les Israéliens, et finalement, nous avons utilisé leur argent et leur technologie dans notre espace orbital. Je veux changer cela. Je veux bien coopérer avec tout le monde, mais en partant de nos propres droits et de nos propres capacités financières. Si nous avions plus de temps, je vous expliquerais comment, dans mon esprit, tout cela renvoie à la souveraineté : à l'avenir, l'un des éléments clés de la souveraineté sera la souveraineté des données. La Hongrie doit devenir un pays souverain sur le plan des données. Pour cela, il ne suffit pas d'avoir des systèmes de stockage ou de traitement : il faut aussi des systèmes d'acquisition des données, et nous devons en être propriétaires. C'est pourquoi il nous faut un satellite à nous, en vertu de notre droit orbital. Et c'est de cela que les entreprises hongroises ont négocié là-bas : comment créer ce satellite, alors que nous ne possédons pas encore la technologie. C'est un peu comme cette vieille blague de fumeurs à l'époque soviétique.
Je ne la connais pas. Quelle est cette blague ?
T'as une cigarette ? Non. Et du feu ? Non. Qu'est-ce que tu as alors pour fumer ? Seulement la bouche !
Oui.
Nous, nous avons le droit, mais la technologie…
Mais nous n'avons rien d'autre. Et maintenant, nous en aurons ?
Maintenant, nous avons l'argent, et nous aurons la technologie. Oui. Nous devions seulement négocier pour que, lorsque nous construirons ce satellite sur une base technologique américaine, nous puissions y intégrer nos propres composants. Autrement dit : fabriquer le plus d'éléments possible nous-mêmes. Mais cela relève des spécialistes. Et nous voulons participer : c'est pour cela que l'espace n'est pas si éloigné de nos réalités, contrairement à ce que votre question laissait entendre. On pourrait croire qu'un petit pays n'a rien à faire là-dedans, que cela paraît absurde. Eh bien non ! Nous avons des droits, nous avons des possibilités, et nous les utilisons.
Nous les faisons valoir. Aujourd'hui, Márton Nagy a annoncé, et nous sommes le 11 novembre, il est midi, que le déficit budgétaire atteindrait 5 % l'année prochaine, et que le gouvernement hongrois augmenterait de 185 milliards le montant de la taxe bancaire. Cela montre tout de même que le gouvernement traverse de sérieuses difficultés financières.
Voyons voir. Si l'on prend comme unité de mesure des difficultés le critère que vous proposez, le déficit budgétaire, puisque c'est bien ce dont vous parlez…
Entre autres, oui. Mais il y a d'autres chiffres.
Bien sûr. L'image est complexe. Mais pour ce qui est du déficit : en 2024, il est de 5 %. En 2025, 5 %. Nous sommes en novembre, et en 2026, ce sera encore 5 %. J'aurais voulu le ramener à 3,7 %, mais je n'y arrive pas, nous n'y arrivons pas : ce sera 5 %. Mais il n'augmente pas, pour être clair.
Il augmente par rapport aux prévisions.
Oui, mais la réalité dans laquelle nous vivons, c'est : 2024, 5 ; 2025, 5 ; 2026, 5. Et je dois dire que tant que la guerre ne prendra pas fin, tant que nous ne pourrons pas instaurer la paix, il sera très difficile de faire mieux. C'est d'ailleurs ce qui a fait échouer mon intention : j'aurais voulu atteindre 3,7 %. Si la guerre s'était terminée en juillet, si un accord de paix avait été trouvé, nous aurions peut-être pu le faire. Mais ce ne sera pas le cas, je le vois bien maintenant…
Et vous dites la même chose pour la croissance. C'était combien, déjà ? Vous espériez 3,4 %. Maintenant, on se réjouira si on atteint 0,6 % cette année.
Oui. Il faut compter cela…
Et cela aussi, c'est à cause de la guerre ?
Bien sûr. C'est une règle empirique. La règle empirique, que nous avons apprise ces trois dernières années, c'est que sans guerre, notre croissance est environ trois fois plus élevée. Ce n'est pas une règle hongroise, c'est une règle européenne, pour ne pas dire allemande. Les pays fortement intégrés à l'espace économique allemand suivent grosso modo la même trajectoire : l'Allemagne elle-même et l'Autriche également. C'est pourquoi il est vital pour nous de mettre fin à la guerre. Chaque point de croissance représente environ 400 milliards de forints pour le budget. Je pourrais aussi dire que c'est ce que nous perdons à cause de la guerre. Si elle n'existait pas, et si notre croissance était à 3 % plutôt qu'entre 0 et 1 %, nous disposerions de 800 milliards de forints supplémentaires, que nous n'avons pas.
Permettez-moi de revenir un instant en arrière, j'avais oublié de vous poser une question.
Excusez-moi, mais…
Oui.
Si vous le permettez, restons encore un instant sur le déficit. Le déficit n'a pas de sens en soi. On peut faire un déficit à 3,7 %.
La question, c'est : sur quoi ne dépense-t-on plus ?
Oui. Vous le formulez ainsi, mais dans mon esprit, la question est : qu'abandonne-t-on ? Parce que je suis dans un système de reddition de comptes : on se présente aux élections, on fait des promesses, les gens, dans le meilleur des cas, les acceptent, et vous devez ensuite tenir ces engagements. En 2022, j'ai promis un certain nombre de choses, et je ne veux renoncer à aucun de ces objectifs. Malgré la guerre, malgré notre incapacité à instaurer la paix, malgré les mauvaises sanctions, malgré Bruxelles qui a tout raté, et là, il faudrait une discussion à part : comment tant d'esprits brillants peuvent-ils prendre tant de mauvaises décisions ? Ils ont échoué, ils ont gâché les choses, et nous en payons le prix. Mais moi, je ne veux renoncer à aucun de mes objectifs. Je dois seulement accepter, ce qui n'est pas facile pour quelqu'un comme moi, un calviniste têtu, ce n'est pas simple…
Vous êtes têtu ?
Oui, oui. Mais je dois accepter que nous ne pouvons pas tout réaliser au rythme que nous souhaiterions. En revanche, je ne suis prêt à renoncer à aucun objectif. Je suis prêt à rééchelonner, à avancer plus lentement, mais pas à abandonner. Et nous en sommes arrivés à ce dilemme : pour tenir un déficit à 3,7 %, j'aurais dû renoncer à l'un ou l'autre de mes objectifs. Comme beaucoup de choses ont déjà été annoncées, et que d'autres doivent encore l'être, ce sont surtout les objectifs que nous n'avons pas encore présentés publiquement qui se trouvaient menacés, mais moi, je veux les atteindre, parce que je m'y suis engagé en 2010, j'en ai le devoir.
Quels sont les axes que vous n'avez pas encore annoncés ?
De nouvelles formes de soutien aux petites et moyennes entreprises.
Avant les élections, ou plutôt à partir du 1er janvier, j'imagine ?
La semaine prochaine, je me rends à une réunion où, si nous parvenons à un accord, je signerai avec la Chambre de commerce et d'industrie un paquet de réduction d'impôts pour les petites entreprises, d'un montant de 70 à 80 milliards. Il faut bien trouver ces fonds quelque part.
Cela concernera quels impôts ?
Il existe une liste : c'est la Chambre qui l'a proposée, et nous avons négocié avec elle. Nous nous sommes déjà mis d'accord avec la Chambre, mais cela coûtera cher l'année prochaine, sur la baisse des taux d'intérêt de la Carte Széchenyi. Cela signifie que nous accordons une subvention d'intérêts plus importante.
Les 300…
Oui, environ 300 milliards de forints. Ce n'est pas de la petite monnaie. Et puis il y a notre programme « 1+1 » : cela veut dire que lorsqu'une petite ou moyenne entreprise hongroise présente un projet d'investissement et qu'elle est prête à mettre un forint sur la table, le Programme Sándor Demján en met un autre en complément. C'est l'ancien plan Széchenyi, si vous vous en souvenez…
Oui.
Celui de 2002. Ce programme mobilise 130 milliards de forints. Donc : 70 milliards pour l'accord avec la Chambre, 130 pour le programme Demján, et 300 pour le taux réduit de la Carte Széchenyi. Et je dois trouver cet argent quelque part : je ne veux renoncer à rien. Et le prix à payer, c'est que le déficit sera de 5 % au lieu de 3,7 %.
Je me rends compte que je ne vous ai pas reposé la question : qu'en est-il alors de la visite du président Trump ? Vous avez dit que s'il y a un sommet à Budapest…
Oui.
…entre les deux présidents, ce serait évident. Et sinon ?
Je vous l'ai déjà dit : je ne peux pas répondre à cela.
Vous l'avez invité ?
Il y a une invitation permanente. Je l'ai invité dès sa première élection. Je lui ai dit : « Monsieur le Président, votre épouse est slovène. La Slovénie est notre voisine.
Allez rendre visite à la famille.
Si vous vous rendiez chez vous ? » C'est exactement ce que je lui ai dit. Et je connais son épouse.
Merci…
Je connais également son père.
Comment cela ?
Lors d'une de mes rencontres avec le Président, il y a eu ensuite un dîner à Mar-a-Lago. Son épouse était là, et son père aussi : c'est ainsi que je l'ai rencontré. Un homme parfaitement centre-européen : il pourrait très bien être assis ici à discuter avec nous. Slovène. Un Slovène tout simple, un brave homme.
Revenons à l'économie. Il y a des chiffres franchement effroyables. L'Office central de la statistique (KSH) a révisé les données sur la pauvreté. J'imagine que vous les avez vues ?
Non. Je ne les ai pas vues.
Elles indiquent qu'en 2024, près de 19,4 à 20,2 % de la population était touchée par la pauvreté ou par le risque d'exclusion sociale. Et il y a un autre chiffre, concernant la pauvreté infantile. Cette donnée a été révisée : l'office de la statistique avait auparavant annoncé 9,5 % au gouvernement comme au public, mais le chiffre réel est de 20,9 % Un enfant sur cinq vit dans une pauvreté profonde ou est frappé par la pauvreté.
Est menacé. Est menacé.
Aussi. Menacé, ou déjà pris dedans.
Ce n'est pas tout à fait la même chose.
Certes, mais…
Exposé au risque, disons.
C'est énorme.
Bien sûr, mais tout dépend de l'angle de vue. Évidemment que c'est énorme : un seul enfant, ce serait déjà trop.
Oui. Mais ce chiffre est exceptionnellement mauvais même à l'échelle de l'Union européenne.
Non, ce n'est pas vrai.
Si.
Non.
Pour ce dernier chiffre, même le KSH dit que c'est grave.
Revoyons cela lors du prochain entretien.
Faisons-le !
Moi, je regarde toujours les données sous deux angles, car un chiffre, en soi, ne s'interprète pas tout seul. D'abord : d'où partons-nous et où en sommes-nous ? Sommes-nous dans une tendance d'amélioration ou de dégradation ? La situation n'est pas bonne, mais elle est meilleure qu'avant. Ensuite : dans notre environnement culturel, disons, dans l'Union européenne, où se situent ces chiffres ? Je considère toujours ces deux aspects. Et si ceux-ci sont satisfaisants, je peux dire que la trajectoire est bonne : nous n'avons pas encore atteint nos objectifs, il reste énormément de travail, mais la trajectoire est bonne.
Vous avez vraiment l'impression que la trajectoire est bonne ?
Sur la pauvreté, absolument. Bien sûr que oui !
Pourtant on dit que ceux qui ne sont pas rejoints par les aides familiales sont précisément ceux qui se retrouvent dans cette situation.
Mais selon moi, en Hongrie, il n'existe pas d'enfant qui ne soit pas couvert par l'un des dispositifs de soutien familial. Ça n'existe pas !
Alors comment peut-il y avoir autant d'enfants pauvres ?
C'est pour cela que je vous dis : je suis prêt à me préparer et à revenir sur ce sujet la prochaine fois, pour bien examiner comment il faut lire ces chiffres. Parce que vous me parlez d'une donnée statistique.
Oui, oui.
D'un seul chiffre.
Publié il y a une semaine par l'Office central de la statistique.
Oui. On appelle cela une « ventilation ». Examinons-le, je serais ravi d'en discuter avec vous. Voyons les ventilations : la répartition géographique, la répartition ethnique, s'agit-il d'enfants roms ou non, d'enfants de Budapest ou de province, de l'Est ou de…
Les enfants roms sont aussi des enfants hongrois.
Oui, oui, bien sûr, mais cela constitue tout de même un groupe spécifique, ce n'est pas indifférent. Lorsque vous identifiez un problème, il faut en connaître la décomposition, la structure profonde. Quand une moyenne est mauvaise, mais que vous découvrez une énorme disparité territoriale, il ne faut pas intervenir là où tout va bien, mais là où ça va mal. Et il ne faut pas être pudique sur ces sujets. En matière de pauvreté, oui : les enfants roms sont plus touchés que les autres enfants hongrois.
C'est effectivement le cas.
Mais ce sont tous des Hongrois, c'est bien pour cela que nous en parlons, car sinon, qu'avons-nous à voir avec eux ? Nous en parlons parce qu'ils font partie de nous. Partons de là. Mais il faut apporter le remède là où se trouve la maladie, pas là où tout le monde est en bonne santé. Il faut donc examiner les ventilations.
Très bien, faisons cela la prochaine fois !
Pas pour relativiser le problème, je ne suis pas d'accord avec cela.
C'était aussi une promesse : nous n'attendrons pas quinze ans avant votre prochaine venue.
L'entretien n'est pas terminé, patience.
Bon, d'accord. Les retraites. La pension moyenne de vieillesse est actuellement de 243 000 forints, c'est très peu.
Il y a une telle moyenne ?
La pension moyenne de vieillesse ? Bien sûr que oui ! D'après le KSH.
Oui, mais…
La pension moyenne représente 53 à 55 % du salaire moyen.
Oui, mais attendez une seconde. Concernant les pensions aussi, ce n'est pas « une pension », mais « des retraités ».
Certes, mais le montant de la pension…
Oui, oui.
C'est bien le retraité qui la reçoit.
Mais la moyenne dépend de sa composition : combien reçoivent beaucoup, combien reçoivent peu.
Alors regardons la pension médiane, car c'est une donnée plus représentative. Mais elle est plus faible…
Elle est plus faible mathématiquement parlant.
… parce qu'elle s'élève à 214 000 forints.
C'est exact.
C'est vraiment très peu. Nous avons appris de Márton Nagy que la première semaine du 14ᵉ mois de pension sera versée l'année prochaine ; c'est aussi une annonce d'aujourd'hui. Vous savez déjà quand ce versement aura lieu ? Sachant que le 13ᵉ mois, lui, arrive en février.
Revenons donc au point de départ et je répondrai ensuite, si vous le permettez.
D'accord !
Pour ce qui est des retraites, la question est : quel a été le plus grand coup porté aux retraités jusqu'au début de notre gouvernement, appelons-le ainsi, notre gouvernement national, et ne chipotez pas en disant que l'autre aussi était hongrois et national.
Je n'ai rien dit.
Il faut bien nommer les choses.
Vous avez vu mon visage ?
Oui, oui. Oui, oui. Il faut bien appeler les choses : « national, chrétien », c'est trop long, alors pour faire simple, appelons-le gouvernement national. Donc, depuis qu'il y a un gouvernement national en Hongrie, j'ai appris que la plus grande peur, issue de la période précédente, était que les retraites perdent leur valeur. C'est pourquoi, en 2010, j'ai conclu un accord avec les retraités, pas avec le système de retraite, mais avec les retraités, selon lequel aucun retraité ne perdra la valeur de sa pension. Et, quand l'économie le permettra, non seulement nous en préserverons la valeur, mais nous l'augmenterons.
Mais les retraités ont perdu la valeur de leur pension.
Non, ce n'est pas vrai. Pas un seul…
Si on les compare aux salaires…
…pas un seul…
Monsieur le Premier ministre, il faut les comparer aux salaires, car tous les prix suivent l'évolution des salaires.
Ce n'est pas comme ça. Il ne faut pas les comparer aux salaires, mais aux prix. Et la réalité, c'est que les retraites n'ont pas perdu leur valeur. Il n'y a pas un seul retraité en Hongrie, je vous le dis en toute conviction, dont la pension vaudrait aujourd'hui moins qu'en 2010, qui pourrait s'offrir moins de choses qu'en 2010. Il n'existe que des retraités qui peuvent s'en offrir autant ou davantage. Et c'est un engagement personnel : si je me bats aussi fermement ici avec vous, c'est parce que j'ai pris cet engagement personnel en 2010. J'ai une alliance avec les retraités. Nous avons rendu le 13ᵉ mois. Il n'existait plus en 2010, il avait été supprimé.
C'est effectivement le cas.
Nous avons réussi à le rétablir. Comptez-le aussi. Et maintenant arrive le 14ᵉ mois. Écoutez, le mieux serait de tout donner d'un coup, mais comme vous le voyez, nous en parlions il y a un instant, vu l'état du budget, ce n'est pas réaliste. Comment avons-nous fait pour le 13ᵉ mois ? Quand l'économie était suffisamment solide, nous avons commencé par le restituer par semaines. On a rendu la première semaine. À mon avis, c'est ce qui va se passer maintenant : les retraités recevront la première semaine, ou portion, du 14ᵉ mois.
On voit déjà quand cela pourrait arriver ?
Il y a un ordre à respecter. Je fais partie des « casse-cous prudents » en matière de retraite. Vous ne pouvez pas imaginer ! Vous ne pouvez pas imaginer à quel point le système de retraite hongrois est complexe. Si nous devions poser sur une feuille tout ce qui détermine comment on calcule, pour qui, quand… même la table ne serait pas assez grande pour contenir la feuille ! Est-ce un atout ou une faiblesse du système ? Je ne saurais le dire, mais c'est ainsi.
Ce qui paraît illisible n'est généralement pas…
Oui, c'est louche.
…pas vraiment une vertu.
Très bien. Bref : c'est ainsi. En Hongrie, on calcule la pension selon le nombre d'années travaillées, les cotisations versées au cours de ces années. Ces éléments sont combinés, différentes années sont prises en compte avec différents coefficients, ce qui nécessite une grande détermination pour en sonder les profondeurs. Mais je l'ai déjà fait à plusieurs reprises : nous parlons quand même de deux millions et demi de personnes. Ce n'est pas rien. Il faut creuser encore et encore. Et c'est pour cela que je vous dis : le système existe, on peut faire de bonnes choses à l'intérieur, mais en briser la logique est la chose la plus dangereuse qui soit. Je vous le dis en tant que professionnel du gouvernement : je n'ai jamais vu quelque chose de plus risqué. Vous touchez une vis ici : ça améliore un point, mais ailleurs, automatiquement, une autre vis bouge, et là, ça tourne mal. Il faut donc tout considérer très soigneusement. Donc pour répondre à votre question : le 14ᵉ mois doit être versé comme le 13ᵉ, en l'intégrant dans ce même système. Sauf si, demain au Conseil des ministres, le ministre chargé de l'économie arrive avec une autre proposition, mais pour l'instant, c'est ce que je défendrai demain.
Demain, dans ce contexte, signifie mercredi, pour ceux qui nous regarderont ou écouteront plus tard. Je me demande s'il est vraiment possible d'affirmer que les retraites ont conservé leur pouvoir d'achat, alors que, par rapport au salaire médian, la pension médiane ne cesse de diminuer.
Oui, mais les salaires n'ont rien à voir avec cela.
Mais si, en un sens : inflation, prix alimentaires, tout est indexé sur ce qui détermine le pouvoir d'achat. Donc le pouvoir d'achat des retraités baisse.
Non, non, non.
Non ?
Non.
Donc si vous avez cent mille forints, ce n'est pas « moins » que deux cents ?
Non, il faut mesurer autrement : il existe un panier de consommation spécifique aux retraités.
Oui.
Et il n'y a pas de salaires dedans.
Non.
Oublions cela. Il y a une tendance de gauche…
Un retraité achète effectivement moins souvent une télévision, une voiture…
Je ne souhaite pas vous mettre dans une situation délicate avec mes suppositions malveillantes, mais ce que vous dites, à savoir qu'il faudrait mesurer les retraites non pas au panier de consommation des retraités, mais aux salaires, c'est une idée de gauche. Cette logique-là a causé beaucoup de dégâts dans le monde, et je ne recommande pas de s'y engager. À la place, il y a une autre méthode, celle suivie par la Hongrie. Nous avons un panier de consommation des retraités. C'est toujours un sujet de dispute énorme. L'inflation ressentie, la perception des hausses de prix, est presque toujours supérieure à ce que montrent les chiffres. Et il est probable que les gens aient raison, pas les chiffres. Ce n'est donc pas une question simple. Cependant, il existe un panier de consommation des retraités qui est calculé chaque année. Et les retraites doivent augmenter au minimum du même pourcentage. Si donc l'affirmation est vraie, à savoir que chaque année nous avons augmenté les retraites au même rythme que l'évolution du panier de consommation des retraités, alors personne n'a vu sa pension perdre de valeur. Bien sûr, tout le monde, ou en tout cas une très grande partie des gens, voudrait une pension plus élevée, et a le sentiment, à juste titre, que ce serait plus juste. Je pense également que ce serait mieux, et je travaille à ce que cela arrive le plus tôt possible.
Les experts des retraites vont démonter cette discussion, je le vois d'ici.
Défendez-moi, quand même.
Que ce soient les chiffres qui vous défendent. Vous dites qu'il y en a.
Ce qui compte, c'est la logique. Parce que voyez-vous : si vous comparez les retraites aux salaires, et qu'on se trouve dans une période où les salaires augmentent fortement, un « retard » apparaît. Mais dans la vie réelle du retraité, cela n'a aucune importance. Lier les retraites aux salaires est dangereux, car il existe aussi des périodes où les salaires n'augmentent pas. La Hongrie en a connu. Le fait que, depuis que nous gouvernons, les salaires augmentent toujours, ne doit pas tromper les gens : ce n'est pas la règle, c'est plutôt l'exception, un exploit. Et quand les salaires stagnent mais que les prix augmentent, que se passe-t-il pour les retraités si leur pension est indexée sur les salaires ? C'est pourquoi, mon conseil : nous avons un système établi. Depuis trente ans, tout le monde le critique. Il est opaque, difficile, et une partie de ces critiques est justifiée. Il contient des injustices internes. Tout cela est vrai. Mais j'affirme que modifier la logique du système serait plus risqué que de continuer sur la voie actuelle. Et cette voie consiste à augmenter les retraites, sans modifier le mode de calcul, mais en donnant plus d'argent aux retraités. C'est là-dessus que je travaille.
L'inflation alimentaire a été extrêmement élevée au cours des cinq dernières années : plus de 81 %. C'est terrible.
Ne m'en parlez pas…
Le plafonnement des marges est une forme de réponse, je comprends bien. Mais comment sera-t-il possible de le supprimer une fois qu'il ne sera plus nécessaire ? Et surtout : avez-vous l'intention de le supprimer un jour ?
C'est la bonne question. Mais la question n'est pas de savoir quelle est mon intention, plutôt de savoir si nous en aurons la possibilité. Et si le monde évolue dans une direction qui permette d'y mettre fin, ça non plus, nous ne le savons pas encore. Nous nous sommes habitués à un monde où l'inflation était faible, et nous avons tendance à considérer cet état-là comme la normalité. Mais si en Europe, ou dans le monde occidental, l'inflation reste durablement élevée, alors il faudra peut-être vivre plus longtemps avec les instruments conçus pour gérer une inflation élevée. Je ne peux pas répondre aujourd'hui en disant que ce sera le cas ou non, sauf à être doctrinaire et fermer la question par principe. Tout ce que je peux dire maintenant, c'est que sans les plafonds sur les produits alimentaires… attendez : les produits laitiers seraient 50 % plus chers, le lait 50 % plus cher, les œufs 40 %, la farine 50 %, et certains produits laitiers seraient 130-140 % plus cher. Imaginez ce qui se passerait si je supprimais, pardon, si le gouvernement supprimait, ces plafonds. C'est tout simplement impossible. Pas seulement à cause des retraités : impossible en général. Le niveau des prix alimentaires qui existerait sans ces plafonds serait intenable pour la Hongrie.
Il est possible que ça reste en place ?
Je n'en sais rien. Mais il faut rester vigilants. Je regarde cela tous les jours, je suis les rapports. Chaque matin, je commence ma journée en lisant des rapports de sécurité nationale ; dans leur premier tiers figurent les prix de l'énergie et les prix alimentaires.
Si Budapest fait faillite, et avec la forte taxe de solidarité, cela semble devoir arriver cette année, cela ne posera pas seulement problème aux habitants de la capitale et à sa direction, mais peut-être à tout le pays. Même les agences de notation pourraient surveiller ce qui se passe. Le risque en vaut-il vraiment la peine ? Ne faudrait-il pas trouver un accord avec la ville ?
Je pense que les Chinois ont raison : s'il n'y a pas d'ordre dans les mots, il n'y a pas d'ordre dans les idées. Remettons donc d'abord les mots en ordre. À mon avis, la capitale ne va pas faire faillite, première affirmation. Deuxième affirmation : la capitale est en faillite. Voilà la situation. Depuis longtemps déjà, Budapest ne gère plus ses finances comme devrait le faire, dans notre civilisation, une administration publique responsable. Je ne prétends pas que le gouvernement, lui, gère toujours parfaitement, mais nous nous en rapprochons davantage. La situation financière réelle de la capitale n'est plus reflétée depuis longtemps par ses chiffres budgétaires. Nous avons appris cela de Ferenc Gyurcsány : on peut éviter une faillite budgétaire, une année donnée, en utilisant des centaines d'astuces.
Vous parlez des emprunts et des reports de paiements ?
Des emprunts, des prêts accordés par des sociétés… oui.
Oui, oui.
C'est le monde financier moderne. Je suis plus âgé : pour moi, c'est déjà trop complexe. Quand j'étais jeune, quand j'étudiais et que je traitais ce genre de questions, l'éventail des instruments financiers était beaucoup plus réduit qu'aujourd'hui. Désormais, il existe des systèmes extrêmement sophistiqués, comme en Europe de l'Ouest.
Vous êtes en train de dire que la ville utilise des astuces ?
Ça donnerait l'impression que je les accuse. Je ne les accuse pas. Ils bricolent, bien sûr : sans cela, ils ne pourraient pas faire leur budget.
Oui, mais on ne peut pas tirer sur la corde indéfiniment : il faut bien trouver une solution un jour.
Gyurcsány et les siens ont tiré très longtemps, eux aussi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avec une logique budgétaire classique, on peut dire que la capitale est en faillite depuis longtemps déjà, simplement, ils s'en sortent « à la débrouille », comme on dirait accoudé à un comptoir. Mais cela ne change rien au fait que, comme vous le dites, ce n'est pas viable à long terme. Pourtant, c'est une ville très riche. En réalité, elle est pleine d'argent. Pleine !
Ils disent que ce que l'État leur retire dépasse ce qu'il leur donne…
Ce n'est pas vrai. Ils ne disent pas la vérité.
…et qu'ils sont donc constamment dans le rouge.
Excusez-moi, qu'entendez-vous par « leur donner » ? Selon vous, combien…
Il y a un accord, et même la Cour constitutionnelle et le tribunal ont dit qu'il n'était pas acceptable que l'État retire plus qu'il n'accorde…
Non. Ni les tribunaux ni la Cour constitutionnelle n'ont jamais dit une chose pareille. C'est une erreur.
C'est pourtant ce dont se prévaut la capitale.
Alors c'est la capitale qui le dit, pas les tribunaux. Monsieur le rédacteur en chef, ce n'est pas la même chose. Enfin, passons : les choses ne sont pas comme ils les présentent. Il n'existe aucun jugement de ce type.
Alors qu'en est-il ?
La situation est la suivante : aujourd'hui, des investissements publics de plusieurs centaines de milliards, à mon avis, près de mille milliards de forints, sont en cours dans la capitale, financés non pas par la ville mais par le budget national. La capitale est la grande gagnante de ces quinze dernières années. Des choses se sont faites ici que la ville n'aurait jamais pu financer seule. Beaucoup reste à faire, certes. Mais l'essentiel de ce qui a été réalisé l'a été avec de l'argent de l'État. Donc, quand la capitale dit qu'elle est traitée injustement par le gouvernement, c'est un miracle que le plafond ne nous tombe pas sur la tête. Aucune ville, et même aucune région, de ce pays ne serait pas heureuse d'obtenir ne serait-ce qu'un dixième de ce que Budapest reçoit chaque année en investissements. C'est la première chose.
Oui, mais combien la capitale produit-elle ? Beaucoup.
Mais permettez-moi d'attirer votre attention sur un point. D'après ce que j'ai lu, je n'ai pas vu la séance moi-même, le ministre Navracsics a passé une audition extraordinaire devant une commission parlementaire. Les ministres doivent s'y présenter une fois par an, et lui est responsable du développement territorial. Je n'ai vu que la transcription, mais tout y est : il a expliqué que 1,7 million de personnes vivent dans la ville. Mais sa zone d'attraction et le nombre de personnes qui font tourner son économie, ce sont 5 millions de personnes qui n'y vivent pas. Donc prudence ! Parler de la situation de la capitale avec des lunettes partisanes est une erreur. Et l'attitude qui consiste, depuis longtemps, pas toujours, mais souvent, à gouverner la ville en disant : « le gouvernement est mauvais, la ville est bonne ; si le gouvernement nous donnait plus d'argent, tout irait mieux ». C'est assez médiocre, non ? Dans le cas d'une ville qui…
Je vais essayer de traduire cela…
Excusez-moi : dans le cas d'une ville qui, par rapport au reste du pays, se développe à une vitesse fulgurante… Où est la justice, là-dedans ?
Oui, mais elle génère énormément de ressources pour cela.
Bien sûr, mais pardonnez-moi : je ne cherche pas à dénigrer Budapest.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si vous allez essayer de trouver un accord avec Budapest. Est-ce que vous allez tenter de vous entendre avec Gergely Karácsony ?
Mais il ne s'agit pas de « s'entendre ». Il s'agit de gouverner cette ville. Et si ça ne marche pas, ils viendront, et alors nous réglerons le problème. Nous aiderons. C'est pour cela qu'un gouvernement existe. Je ne veux pas « m'accorder » avec eux. L'accord, ça servirait d'excuse pour ne pas gouverner correctement la ville. Qu'ils la gouvernent bien, point. Ils ont accepté la responsabilité : c'est une ville très riche, qui a énormément d'argent et un énorme patrimoine. Je le redis : n'importe quelle commune de province s'estimerait heureuse d'avoir ne serait-ce qu'une fraction des possibilités dont dispose ici la capitale. Donc il est légitime, je ne parle pas du gouvernement, mais du reste du pays, d'attendre que cette ville soit gérée correctement. Si cela ne leur réussit pas, on peut toujours accuser le gouvernement, bien sûr. Mais si ça ne marche pas, il n'y a pas de catastrophe. Jamais personne n'a fait faillite dans ce pays depuis que je suis au gouvernement, depuis que nous sommes au gouvernement. Aucune ville n'a fait faillite ici. Nous aidons tout le monde. Nous avons commencé en 2010 par retirer environ 300 milliards de forints de dettes des épaules de cette ville, de la capitale. C'était notre première décision. 300 milliards de forints de dette ! Et nous avons fait la même chose pour toutes les autres communes. Le gouvernement n'est pas là pour compliquer la vie des autres, mais pour l'alléger. Donc, s'ils ne peuvent pas résoudre le problème, alors le gouvernement les aidera.
Quelle déception est-ce pour vous, personnellement, György Matolcsy et la manière dont la Banque nationale a fonctionné, notamment d'après ce que Varga Mihály dit avoir trouvé une fois installé ?
Je n'y vois pas encore très clair. Et puis j'ai un lien affectif très fort avec le gouverneur de la Banque centrale, avec les deux, d'ailleurs : le précédent comme l'actuel. Mais je peux dire que l'ancien, György Matolcsy, je lui dois énormément. Non seulement moi personnellement, même si c'est vrai aussi : sur le plan intellectuel, j'ai beaucoup appris de lui, mais le pays également. Il a sorti la Hongrie de situations difficiles dont, selon moi, personne d'autre n'aurait été capable de l'extraire. Et il m'a énormément aidé à concevoir et dessiner cette nouvelle économie hongroise qui a vu le jour depuis 2010. Je trouve que c'est quelque chose de fantastique, ce qui est arrivé depuis 2010. C'est une autre Hongrie, surtout du point de vue économique.
Beaucoup contestent le bien-fondé de cette transformation, toutefois…
Je ne dis pas que tout va bien. Je ne suis pas François-Joseph, « tout est beau, tout est parfait, je suis satisfait de tout », je ne suis pas idiot, pardonnez-moi. Je vois très bien les difficultés, je vois que nous avons encore énormément de travail. Mais c'est une autre économie. Une bien meilleure économie. Une économie résistante aux chocs, capable de se développer. Pourquoi les citoyens ont-ils voté pour nous en 2010 ? Ne l'oublions pas. Pourquoi, selon vous, m'ont-ils rappelé ici pour gouverner ? Parce qu'ils m'aimaient bien ?
Ils ne vous aimaient pas ?
À mon avis, la majorité ne m'aimait pas.
Ils ont cru que vous étiez capable, malgré tout.
Oui. Mais pourquoi l'ont-ils cru ?
Parce qu'ils étaient déçus du Premier ministre précédent, et qu'ils avaient un bon souvenir des quatre années 1998-2002.
C'est pour notre travail qu'ils nous ont rappelés. Pour notre travail, pardonnez-moi…
Mais vous ne répondez pas vraiment… Alors que…
…et c'est ce que je veux dire : en 2010, ils n'ont pas voté avec leur cœur. Une partie du pays, bien sûr, oui. Quand on parle du pays, on parle d'une grande diversité. En tout cas, une grande partie a voté avec sa raison. C'est pour cela qu'ils nous ont rappelés. Et une grande partie, aujourd'hui encore, restera avec nous pour le même motif : parce qu'elle écoute sa raison. Mais bon, c'est un autre sujet. Pour ce qui est du passé, on n'a plus besoin de deviner : on le connaît. Donc voilà : c'est ce qui s'est passé. En 2010, nous n'avons pas simplement colmaté des trous, nous avons construit une économie d'une structure entièrement différente. Et même si le temps nous manque, je pourrais vous l'énumérer : par rapport à 2010, notre système fiscal est complètement nouveau. Tout repose sur la performance. Depuis 2010, je n'ai laissé entrer dans l'économie hongroise que des éléments destinés à améliorer sa compétitivité. Les impôts sont plus bas, le système est différent. Les règles du travail sont beaucoup plus flexibles. Quelqu'un qui veut travailler peut bien plus facilement travailler. Nous ne donnons pas d'argent sans contrepartie : uniquement à ceux qui sont réellement incapables de contribuer par quelque travail que ce soit, d'où le système des emplois publics, etc. Et notre système de soutien aux familles, qui fait l'objet de grands débats : partout où c'était possible, j'ai lié la démographie au soutien familial, la performance et l'économie.
Je comprends cela. C'est bien ce que je vous demandais. Je vous interrogeais sur Matolcsy. Vous gagnez sur lui 500 milliards de forints.
Bon, maintenant ce n'est plus autant, mais j'y reviendrai. Ce que je veux dire…
Même 400 milliards, ce n'est pas négligeable.
Oui, mais ce n'est pas autant. Donc, revenons-y. Ce que je veux dire, c'est que la réponse que je vais vous donner, prenez-la avec des réserves.
D'accord.
Donc, étant donné tout ce dont nous venons de parler, que c'est une économie différente, structurellement une autre économie, et que cette autre économie, nous n'aurions pas pu la construire sans György Matolcsy. Point. Voilà son mérite. Et quoi qu'il se soit passé depuis, cela reste vrai. C'est un bloc de roche posé là, c'est comme ça.
Vous n'oubliez pas ses mérites, je comprends.
Exactement !
C'est ce qui est juste.
Voyez-vous, l'équité, la justesse, c'est la vertu gouvernementale la plus importante, sans doute même la plus importante des vertus humaines : mesure et équité. Deux mots-clés. Si l'on reste sur cette voie, on ne peut pas se tromper gravement. Donc soyons équitables. Quant à la gestion de la Banque nationale, sujet d'un immense débat : y a-t-il eu gaspillage, y a-t-il eu vol, où est passé l'argent, etc. L'enquête est en cours. Ça n'a pas l'air bon. Je ne vois pas ce que j'aimerais voir : je vois plutôt des problèmes. Mais j'attends la fin des investigations, et à ce moment-là je répondrai volontiers à votre question.
À propos de l'affaire de l'application Tisza…
D'autant que, et je ne sais pas à quel point ceux qui nous écoutent le savent, en Hongrie, ce n'est pas comme si vous pouviez entrer quelque part avec un pied-de-biche, forcer un coffre-fort, mettre l'argent dans un sac et vous en aller. L'économie hongroise n'en est plus là. Aujourd'hui, derrière chaque mouvement d'argent, il y a une décision. Derrière chacun ! Donc on peut savoir qui a décidé. Il y a partout un board, une direction. Partout un conseil de surveillance.
Et même, il y a eu une décision parlementaire qui a ouvert la voie à certaines choses en 2017.
Oui, mais quand la décision concrète est prise sur un seul forint, il y a de la documentation. Il y a un commissaire aux comptes, il y a un comptable. Vous voyez ? Donc ce n'est pas comme si Matolcsy ou quelqu'un d'autre avait juste crié « allez hop ! », et…
C'est pour ça qu'on dit que c'était une performance intellectuelle, la manière dont la « brouette » est partie.
C'est bien pour cela, puisque c'est comme vous le dites, qu'il faut attendre la fin de l'enquête. Ce que j'ai vu jusqu'ici n'est pas beau. Vous-même avez évoqué les déclarations du nouveau gouverneur de la Banque nationale. Ce n'est pas beau, mais il faut tout voir, et alors seulement porter un jugement, pour rester équitables. Bien sûr, si ne serait-ce qu'un forint a disparu de manière irrégulière, il doit avoir un responsable, quelqu'un devra en répondre. Et il répondra.
Il y a maintenant une affaire de vol ou de fuite de données avec l'application Tisza, on ne voit même pas encore clairement ce que c'est. Les enquêtes sont également en cours. C'est une question qui peut même influer sur une élection libre, puisqu'on a pu apprendre, ou certains ont pu apprendre, des choses sur des personnes auxquelles personne n'aurait dû avoir accès : qui est électeur du principal parti d'opposition.
Oui, je trouve un peu exagéré de dire que cela pourrait influencer une élection, mais c'est un domaine très intéressant, car nous sommes en train d'apprendre. Nous sommes en train d'apprendre, comme je vous le disais, ce que signifie la souveraineté des données au niveau de la nation. Et il existe aussi une souveraineté des données au niveau de l'individu. Vous aussi, vous êtes une personne souveraine, non ?
J'espère bien.
Mais si vous n'êtes pas souverain quant à vos données, alors votre souveraineté est atteinte, non ?
C'est ce que je veux dire, ici…
C'est cela que nous sommes en train d'apprendre.
Beaucoup de gens sentent aujourd'hui, ou peuvent sentir, que personne n'a à s'immiscer dans leurs préférences politiques.
Oui, oui. C'est exact. C'est pour cela que c'est un cas d'école. Ce n'est pas simple à comprendre. Moi aussi, j'apprends encore à appréhender tout cela.
Quand les hackers russes sont entrés dans le ministère des Affaires étrangères, qu'en avez-vous pensé ?
Je n'ai rien pensé, j'ai envoyé immédiatement tous les spécialistes compétents.
Nous savons déjà ce qui s'est passé ?
Bien sûr. Vous savez, autant que possible dans ce monde moderne… À quoi sommes-nous habitués ? Vous entrez dans une pièce, vous allumez la lumière, il fait clair, simple, non ? Maintenant, les données apparaissent sur un écran, disparaissent, on ne sait même plus ce qui est où : c'est un autre monde. Je n'oserais pas affirmer que, dans l'univers des fraudes informatiques, chaque affaire puisse être entièrement élucidée jusqu'au dernier détail. Je n'oserais pas le dire. Celle-ci peut peut-être l'être, mais il faut un expert pour cela, et je ne me sens pas le courage de prétendre le contraire. Mais je sais une chose : celui qui est responsable des données, ici, le ministère des Affaires étrangères, c'est-à-dire l'État hongrois, a l'obligation absolue d'aller au bout de l'enquête. De quoi s'agit-il ? Quelqu'un vous confie ses données, dans l'idée qu'elles seront conservées, que seule la personne que vous voulez pourra y accéder. Personne d'autre. Si vous demandez des données, vous devenez responsable des données.
C'est pourquoi, en particulier…
C'est valable au ministère des Affaires étrangères aussi. Et si vous êtes responsable des données, vous avez une responsabilité morale, parce que vous devez cette sécurité à la personne concernée, et une responsabilité juridique, définie dans la loi. Il faut garantir cela. Si vous ne le pouvez pas…
Je suis content que vous parliez de morale.
Bien sûr : être responsable des données, c'est d'abord une question morale. Vous manipulez les données d'autrui. Donc…
C'est aussi une question morale que de ne pas publier ces données dans la presse.
Discutez-en entre vous. Si je comprends bien…
Les médias pro-gouvernementaux sont quand même tombés dans ce piège.
Écoutez, ne me mettez pas sur le dos les médias pro-gouvernementaux.
Je ne vous mets rien sur le dos, je vous demande votre avis.
Cette discussion n'a pas été comme ça jusqu'ici.
C'est votre opinion que je voudrais connaître.
Ne me rendez pas responsable de choses qui ne vous plaisent pas mais qui ne me concernent pas. Je n'ai pas prononcé les mots « médias pro-gouvernementaux » ou « médias d'opposition ».
Certes.
C'est une autre discussion, je suis prêt à la mener, mais ce n'est pas le sujet maintenant.
Très bien, faisons autrement. Certains médias, essentiellement en ligne, ont publié ces données, qui sont des données personnelles, sensibles, soulevant des questions éthiques et privées. Qu'en pensez-vous ?
Que c'est au responsable des données de les protéger. Il ne peut pas dire : « Oui, je suis un incapable, négligent et irresponsable, je n'ai pas su protéger vos données, mais regardez, ces cochons les publient ! » Quel genre d'argument est-ce là ?
Le gouvernement sait-il déjà que cela vient d'une source ukrainienne ?
Le point de départ…
Puisque cela a été dit.
Le point de départ, c'est qu'il y a un responsable des données, qui a une responsabilité morale envers vous. C'est de là qu'il faut partir. Il y a aussi des règles juridiques, vous avez raison, ce n'est pas négligeable mais c'est secondaire. Ce que je ne comprends pas encore, car je n'ai pas encore obtenu de réponse, c'est pourquoi il a fallu créer un programme qui a été, en partie ou en grande partie, développé par des Ukrainiens ? Nous avons quantité de brillants informaticiens hongrois. Deuxièmement : je ne comprends pas pourquoi, parmi les huit-dix principaux responsables des données, l'un d'eux se trouve en Ukraine. Quel est le sens de cela ? Mais ce n'est pas à moi d'y répondre : les services secrets enquêtent, le gouvernement recevra un rapport, et alors je serai moi aussi plus au clair, et pourrai peut-être répondre à votre question.
Pourquoi ne voulez-vous pas débattre avec votre challenger, Péter Magyar ? Il y en avait l'occasion à Győr : vous y êtes tous deux ce week-end, le maire avait même dit qu'il organiserait tout. On dit que vous y avez réfléchi, puis finalement vous avez renoncé.
Je n'y ai pas réfléchi du tout.
Non ?
J'ai un challenger, mais il ne s'appelle pas Parti Tisza, il s'appelle Bruxelles.
Mais les citoyens ne vont pas voter pour Bruxelles…
Si, justement.
…mais pour le parti Tisza.
Je veux clarifier cela : vous vous trompez. Ils voteront pour Bruxelles. Car Tisza est un projet construit depuis Bruxelles. Financé depuis Bruxelles, maintenu en vie depuis Bruxelles, soutenu par les centres de pouvoir qui s'y trouvent. Celui qui vote pour le parti Tisza vote pour Bruxelles.
Oui, mais enfin, il y a deux millions de personnes qui pensent que ce n'est pas comme ça, mais que c'est elles qui soutiennent…
Oui, je comprends.
…et que c'est elles qui ont imaginé tout cela.
Je comprends cela.
Elles ne méritent pas plus de respect ?
Je comprends qu'elles le pensent. Avec tout le respect et toute l'humilité possibles : elles se trompent. Mon rôle n'est pas de les conforter dans leur erreur, mais de les aider à comprendre la vérité.
Donc cela veut dire qu'il n'y aura aucun débat. La question est tranchée.
Si. Il y a un débat.
En face-à-face avec Péter Magyar, en public.
Moi, je débats avec ceux qui sont les adversaires de la Hongrie, ceux qui veulent un autre gouvernement que le gouvernement national. Ils veulent un gouvernement bruxellois. La tête de ce serpent est à Bruxelles. C'est avec Bruxelles que je débats, pas avec les intendants hongrois, les mandataires hongrois. Je ne vais pas non plus dans un journal ou dans un forum financé depuis l'étranger. Donc pour moi, il n'y a pas de médias pro-gouvernementaux ou d'opposition. Je ne vais nulle part pour parler avec quelqu'un, ou dans un média, qui est financé de l'étranger. Je n'y vais pas.
L'affaire des grâces : à quel point cela vous fait encore mal ? Le fait qu'elle ait éclaté comme elle a éclaté, la manière dont nous l'avons gérée, et ses conséquences.
Mais regardons ce qui fait vraiment mal, c'est ce que je voulais dire.
Qu'est-ce qui vous fait mal, à vous ?
Le manque de judicium, c'est-à-dire l'altération du jugement. Parce que, qu'est-il arrivé ? Il est arrivé, si je comprends bien ce que la Présidente de la République a dit, car je ne peux m'appuyer que sur ce qu'elle a expliqué, qu'elle a accordé la grâce à une personne dont elle pensait qu'elle n'avait pas commis ce pour quoi elle avait été condamnée. C'est le point de départ. Elle n'aurait pas dû accorder la grâce ; elle aurait dû dire : « J'ai confiance dans le jugement de la justice », ou je ne sais quoi. Mais en aucun cas elle n'aurait dû prendre sur elle ce fardeau : prendre seule, à la place du tribunal, une décision dans un domaine qui touche à des questions morales, sensibles, fondamentales. C'est cela que j'appelle le manque de judicium, de discernement. C'est ce qui s'est passé.
De la contrariété ou un défi…
Une douleur.
…c'est ce qui se produit depuis lors dans la politique intérieure hongroise.
Vous savez, je construis une forteresse avec des gens. C'est mon métier. Et une forteresse très solide : on appelle cela un gouvernement, et aussi une nation. Ce n'est pas une exagération ni de la grandiloquence. C'est ainsi que je vois mon travail. Et des piliers porteurs ont été enlevés de cette construction. La Présidente de la République d'abord, puis elle a entraîné avec elle la ministre de la Justice. Pas du point de vue de leur situation personnelle, cela m'importe moins, même si j'entretiens avec elles des relations amicales, et à ce titre aussi ça fait mal, mais du point de vue du pays : c'est une perte énorme. Parce que nous parlons de deux femmes honnêtes, au fond, c'est de cela qu'il s'agit, deux femmes politiques honnêtes, dotées d'une expérience extraordinaire. Nous avons très peu de personnes capables d'être envoyées n'importe où dans le monde, de représenter la Hongrie non seulement avec une qualité irréprochable, aucune provincialité, un niveau international, mais aussi avec efficacité. Comptez-les : combien y en a-t-il aujourd'hui en politique ? Très peu. C'est une immense perte pour toute la nation hongroise, pour la politique hongroise, pour la droite, pour le Fidesz, et pour moi personnellement, dans cet ordre. Oui, chaque élément de cette affaire fait mal.
Avez-vous essayé de rappeler Judit Varga, ou bien était-ce un coup monté médiatique de ces derniers mois ?
Je ne l'ai jamais rappelée.
Vous avez dit qu'elle était une femme politique de niveau « premier ministre ».
Oui, vous voyez : mais le temps verbal compte.
Du passé ?
C'est vous qui l'avez dit.
Vous auriez pu imaginer qu'elle soit votre successeure ?
Pas directement, mais dans un second temps, oui. Parce qu'on est habitués, et les jeunes aussi, les pauvres, ne voient plus que moi depuis si longtemps, mais c'est quelque chose d'exceptionnel dans la vie d'un pays. Même si, selon moi, c'est très avantageux : les avis divergent, mais je pense que c'est très avantageux, même le plus grand atout de la Hongrie, que d'avoir le gouvernement le plus stable de toute l'Europe. C'est ici que le gouvernement est le plus stable. C'est une capacité d'action, une connaissance du terrain, une expérience internationale, comme on le voit avec les négociations aux États-Unis, dont la valeur est inestimable. Mais cela ne veut pas dire que le prochain Premier ministre hongrois restera assis ici pendant des temps immémoriaux comme je le fais. Des successions plus rapides sont possibles. Et d'ailleurs, je ne cherche pas à savoir qui sera, après moi, le leader du camp de droite, mais qui sont ceux qui sont capables de diriger ; et ensuite, la vie suivra son cours, et les membres de notre communauté politique, à ce moment-là, décideront avec leur sagesse propre. Donc, de ce point de vue, je n'imaginais pas qu'elle devienne Premier ministre demain matin. Mais qu'elle fasse partie de celles parmi lesquelles, dans les deux décennies à venir, car nous parlons de femmes jeunes, un Premier ministre pourra émerger, oui.
János Lázár a violemment attaqué Judit Varga…
Parce qu'il pense tout autrement…
…quand la possibilité de son retour a été évoquée…
Oui, János a une manière de penser tout à fait différente. Et je ne peux pas dire qu'il n'y a pas une part de vérité dans ce qu'il dit. Il dit : on peut parler de tout, compétence, intelligence, stature internationale, talent. Mais il y a le travail, dit-il. János est un homme de travail. Il vit dans cette conviction : une seule chose compte, mon ami, qu'as-tu posé sur la table ? Et si tu as signé un mauvais papier, pour quelque raison que ce soit, et que tu t'es trompé dans une affaire à dimension morale, alors qu'est-ce que tu viens faire ici ? János est comme ça. C'est une autre école, pas la mienne. Moi, je bâtis une forteresse avec des gens, avec toutes leurs qualités et toutes leurs faiblesses. Personne n'est parfait, moi encore moins, si vous voulez mon avis.
Bon, maintenant que vous avez dressé les portraits de beaucoup de monde…
Je veux seulement dire que je dirige une communauté, j'essaie de rassembler une situation qui offre le plus grand nombre possible d'options, de marges de manœuvre. János n'est pas ce genre d'homme. Il va droit : « Mon amie, c'était ton travail, ta responsabilité : en tant que présidente, tu t'es trompée, et tu as accordé une grâce. Ministre de la Justice : tu l'as contresignée. Qu'est-ce que vous voulez encore ? » Voilà János.
Je comprends Bruxelles, je comprends votre point de vue, ou je crois le comprendre, mais enfin, vous avez quand même un adversaire en la personne de Péter Magyar. Vous avez dressé le portrait d'un certain nombre de personnes, comment le voyez-vous, lui ?
Mais j'ai décrit seulement des gens de mon camp.
Et votre adversaire, vous ne pouvez pas le décrire ? Vous ne voulez pas ?
Ce n'est pas mon rôle. Pour qui me prendrais-je ? Je vois des choses, d'autres aussi, je crois. Parfois, à cause du combat politique, je suis obligé de dire quelque chose, ça ne me fait pas plaisir, mais la situation l'exige.
Est-ce un adversaire de valeur ?
Je ne dis pas ce genre de choses. Je ne dis pas. Si votre question sur la dignité ou la valeur n'est pas une provocation, si vous voulez vraiment savoir si le monsieur en question est digne…
Absolument.
…alors demandez à sa femme, à son ex-femme. C'est le conseil que je vous donne.
Vous êtes allé à un match de football ce week-end : après la rencontre avec Trump, vous aviez encore l'énergie d'aller au match de Liverpool.
Oh, ho ! Non, c'est plus que ça.
Plus que ça ?
J'étais en study tour. Comment dit-on ? En voyage d'étude.
On vous a montré le stade.
Non, non, non, non…
Un voyage d'étude veut dire ce genre de chose.
Ça, c'est pour les touristes. Non, non, non, non.
Oui.
Je suis considéré comme un professionnel. Je vous prie de m'excuser.
Pardon !
Ici, un nouveau chapitre commence.
Vous avez esquissé la tactique de Liverpool ?
Avec toute la modestie possible, j'essaie d'aborder mon travail avec la modestie nécessaire, mais j'ai une relation différente avec le football. J'ai passé 35 ans dans les vestiaires. Je ne vais pas dire que je m'y connais, car cette phrase n'a pas de sens, mais je veux bien dire que je sais comment ça marche. Et le propriétaire de Manchester City est un bon ami à moi. Prenez-le au pied de la lettre.
Un homme d'affaires des Émirats arabes unis.
Un Émirati. Un homme remarquable, d'ailleurs. Je lui demande parfois son avis sur l'économie, les relations internationales, c'est quelqu'un d'excellent. Et il est comme moi : contaminé. Le football lui est passé sous la peau. Et il a construit un club à partir de rien. Alors je lui ai demandé que, puisque je rentrais d'Amérique, une fois la visite officielle terminée, je passerais en mode privé, et qu'il m'invite pour un study tour comme celui-là. Je l'ai invité, moi aussi, à l'Académie Puskás. Il est venu, je lui ai consacré une journée entière, je lui ai tout montré.
Ce serait assez ironique de vous demander ce qu'il a bien pu apprendre à Felcsút…
Vous seriez surpris, car il y a des choses que nous ne faisons pas mal. Avec la modestie nécessaire. J'ai vingt ans là-dedans, je crois savoir de quoi je parle. Je ne dis pas que tout est comme cela devrait être, ni que nous sommes arrivés au niveau souhaité, mais il y a des choses sérieuses. Je lui ai tout montré : les dortoirs des garçons, la cantine, car c'est essentiel dans le football moderne, les vestiaires, le système de détection des talents, l'organisation des entraîneurs, la structure technique, tout ce qu'on peut montrer. Lui aussi a fait pareil, même plus : il m'a montré ses livres comptables. Ils ont 12 ou 14 clubs, ce n'est pas Manchester City, c'est une confusion fréquente.
C'est un réseau.
Un énorme réseau mondial, et il m'a montré comment chacun fonctionne, dans quels cadres juridiques, avec combien d'argent, etc. J'ai vu beaucoup de choses qui ne me serviront à rien, bien sûr. Parce que c'est un modèle financier mondial, alors que la mission du Puskás, de l'Académie Puskás, ce n'est pas de monter dans la stratosphère internationale, mais de former de bons jeunes hommes et de bons joueurs. Notre objectif est différent. Donc le modèle économique n'a rien à voir. Beaucoup de choses ne sont pas transposables.
Mais c'était sûrement intéressant.
J'ai regardé le système d'évaluation des talents, et j'ai rencontré Guardiola avant le match. J'ai rencontré la moitié des joueurs, à peu près, en traversant les vestiaires…
Là, je commence à vous envier.
On est passés par les vestiaires, j'ai parlé avec le grand Norvégien, qui m'a parlé avec beaucoup de chaleur de Szoboszlai, ils ont joué ensemble à Salzbourg. Et ce sont des types milliardaires, bien sûr, ils vivent dans un autre monde que nous, mais quand il s'agit du vestiaire…cette odeur de vestiaire, c'est la même partout. Moi je dis encore « gérosène », comme dans l'ancien temps. Aujourd'hui ça ne s'appelle plus comme ça.
Mais c'est la même odeur.
Là, il n'y a pas d'échappatoire. Il faut être à la hauteur. C'est là que j'ai appris le plus de choses dans ma vie. Le lycée, c'était important, mais 35 ans de vestiaires, rien ne le remplace. Bref. Et le match, c'était comme la cerise sur le gâteau, je l'ai regardé aussi.
Pas une grande joie. Comme match, c'était bon, mais Liverpool…
J'ai une opinion totalement différente sur tout ça, mais on n'aura pas le temps d'en parler, ce sera pour une autre fois.
Dommage.
Avec quelqu'un d'autre, oui.
Un jour, nous ferons aussi un entretien consacré au football.
Mais ça n'intéresse pas les gens, et à juste titre.
Reviendrez-vous prochainement, ou devrons-nous attendre 15 ans ?
Pardon, les loisirs du Premier ministre, ça n'intéresse personne, et c'est normal.
Le football, si, ça intéresse les gens.
Vous voyez. Mais dans ce cas, je ne suis pas le premier avec qui il faudrait en parler, malheureusement, il y en a d'autres avant moi. Alors, est-ce que je reviendrai ?
Bien sûr !
Je demande simplement que l'ATV n'accepte pas d'argent venu de l'étranger. Je vous demande que, si vous voulez faire une interview avec moi, vous n'acceptiez pas d'argent de l'étranger, et alors je viendrai.
Je pense que nous ne changerons pas là-dessus.
Alors je vous souhaite beaucoup de succès !
Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre ! Merci également pour votre attention. Vous avez regardé l'émission Bilan avec Viktor Orbán. Retrouvons-nous la prochaine fois dans ce programme. Au revoir ! Au revoir !
Prime Minister of Hungary published this content on December 17, 2025, and is solely responsible for the information contained herein. Distributed via Public Technologies (PUBT), unedited and unaltered, on December 17, 2025 at 09:20 UTC. If you believe the information included in the content is inaccurate or outdated and requires editing or removal, please contact us at [email protected]